Irresponsabilité : un projet de loi irresponsable
En avril 2017 à Paris, un homme de 27 ans, manifestement délirant, après s’en être pris à des voisins, a pénétré de force chez Mme Sarah Halimi, âgée de 65 ans, de confession juive. Il l’a frappée, l’a traitée de Satan, a crié à plusieurs reprises « Allah akbar » et l’a défenestrée du troisième étage. L’auteur, déjà condamné plusieurs fois, est un fort consommateur de cannabis.
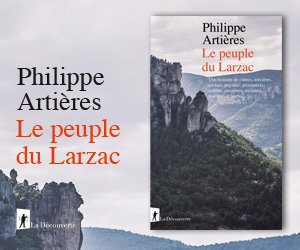
Interpellé immédiatement, il a été placé en hôpital psychiatrique par décision préfectorale, son état étant incompatible avec une garde à vue. Il s’y trouve toujours depuis lors.
L’instruction a suivi son cours. Le caractère antisémite du crime a fini par être admis. Le premier expert psychiatre a conclu à l’altération de la responsabilité. Deux collèges de trois experts chacun ont conclu ensuite à une abolition du discernement. Les juges d’instruction ont prononcé une ordonnance d’irresponsabilité. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision qu’elle a assorti d’une mesure de sûreté de 20 ans.
La cour de cassation, le 14 avril 2021, a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt. Le pourvoi soutenait notamment que la prise volontaire de cannabis qui est un comportement fautif excluait toute déclaration d’irresponsabilité. La cour de cassation se réfère à l’article 122-1 du code pénal qui prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Elle précise : « Les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement. »
Cette décision a déclenché nombre de protestations et manifestations. Ainsi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, a affirmé qu’après cette décision, l’on « peut dans notre pays torturer et tuer des juifs en toute impunité ». Il a été demandé que la loi pénale régissant l’irresponsabilité soit modifiée.
Le président de la République avait, dans un premier temps évoqué « le besoin de procès » pour que « l’on comprenne ce qu’il s’est passé. » Dans un long entretien sur la sécurité donné au Figaro, le 19 avril 2021, le président de la République a demandé « au plus vite » au ministre de la justice « un changement de loi ». Il expliquait sa position : « Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors “comme fou” ne devrait pas à mes yeux supprimer votre responsabilité pénale. (…) Là aussi, pas de fausse impunité. » Le projet de loi doit être déposé en Conseil des ministres fin mai 2021.
En juin 2020, suite à cette affaire, Nicole Belloubet, l’ancienne garde des Sceaux, avait créé une mission pluridisciplinaire composée de praticiens du droit, de médecins psychiatres et de parlementaires afin de réfléchir à une éventuelle modification de la loi sur l’irresponsabilité pénale, « sans remettre en cause le principe essentiel de notre État de droit selon lequel on ne juge pas les fous ». Le rapport a été déposé officiellement le 23 avril 2021. Il formule plusieurs recommandations mais propose de façon très claire de ne pas modifier la loi. Sa recommandation n° 21 est sans ambiguïté : « Conserver la rédaction actuelle de l’article 122-1 du code pénal. »
Le rapport est involontairement cinglant face à la démarche précipitée du gouvernement. Il faut préciser qu’il avait été rédigé avant la volte-face de nos dirigeants. « Il faut rappeler que le droit et en l’espèce le droit pénal s’inscrit dans un système, et ne se résume pas à un empilement de lois et règlements, modifiables selon les circonstances. […] La Garde des Sceaux, Madame Belloubet, suivie par son successeur Monsieur Dupond-Moretti, a choisi d’évaluer avant que de réformer, quand d’autres réforment avant d’évaluer. »
Erreur. Monsieur Dupond-Moretti a changé de camp. Il préfère réformer avant d’évaluer.
Qu’il y ait des degrés dans la folie et conséquemment une appréciation nuancée de l’irresponsabilité n’est donc pas une idée contemporaine.
Le débat sur l’irresponsabilité pénale n’a pas toujours pris ce tour passionné que l’on connaît aujourd’hui. Il a, pendant des siècles, été admis sans beaucoup de réserve.
Au deuxième siècle, l’empereur Marc-Aurèle promulgue la loi « Divus Marcus » : « Si vous voyez clairement qu’Aelius Priscus était dans une fureur continuelle qui le privait de toute sa raison, et qu’il n’y ait pas lieu de soupçonner qu’il ait tué sa mère en feignant d’être furieux, vous pouvez lui épargner la punition, puisqu’il est assez puni par son état… mais s’il avait des intervalles de bon sens, comme cela arrive souvent, vous examinerez s’il n’a pas commis le crime dans ces moments, en sorte que sa maladie ne puisse pas lui mériter la grâce. »
Ces principes ont continué de s’appliquer, si ce n’est pendant le Moyen Âge occidental où une répression féroce s’est abattue sur les sorciers et sorcières prétendument possédés par le diable alors qu’ils étaient manifestement en état de démence.
La grande Ordonnance criminelle d’août 1670 énonçait à nouveau clairement le principe : « Les furieux ou les insensés n’ayant aucune volonté ne doivent pas être punis, l’étant assez de leur propre folie. »
Le code pénal napoléonien de 1810, plus sobrement, prévoyait, dans son article 64 : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action. »
Ce texte restera en vigueur jusqu’en 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau code pénal créant l’article 122-1. Ce dernier prévoyait donc l’irresponsabilité totale en cas de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Mais il concernait aussi le cas où le trouble psychique ou neuropsychique altérait le discernement ou entravait le contrôle des actes. L’auteur, dans cette hypothèse, demeure punissable mais la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Une loi de 2014 a prévu que le maximum de la peine doit alors être réduit d’un tiers.
En fait, cette distinction était prévue depuis longtemps. Elle résultait d’une simple circulaire de 1905. Le savoir psychiatrique avait évolué tout au long du XIXe siècle. Le long travail d’observation, de découverte et de classification de Pinel puis d’Esquirol avait donné naissance à la nosographie classique du début du XXe siècle, qui semblait rendre quelque peu dépassée la simple notion de démence restée figée dans son langage du début du siècle précédent.
Dès lors que l’intervention du médecin psychiatre devenait plus fréquente, les experts se trouvaient rapidement embarrassés de la rédaction et de la conception du texte de l’article 64. Beaucoup des sujets qu’ils examinaient, s’ils n’étaient pas en état de démence, présentaient des troubles sérieux qu’ils ne pouvaient prendre en compte.
C’est pour remédier à cette carence qu’est intervenue le 12 décembre 1905 la circulaire Chaumié, du nom du ministre de la Justice de l’époque. Elle créait une notion intermédiaire entre la responsabilité et l’état de démence : l’atténuation de responsabilité. La mission d’expertise devait répondre aux questions suivantes :
« 1) L’inculpé est-il atteint d’anomalies mentales, psychiques ou physiques de nature à influer sur sa responsabilité ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent.
2) Ces anomalies sont-elles de nature à faire considérer l’inculpé comme étant en état de démence au sens de l’article 64 du code pénal ou seulement à atténuer sa responsabilité et dans quelle mesure ?
3) Le sujet doit-il être considéré comme dangereux pour la sécurité publique ou peut-il être soigné efficacement dans sa famille ? »
Apparaissait ainsi également la notion de dangerosité qui allait faire florès.
Une autre évolution déterminante en la matière résultait d’une loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette loi créait tout d’abord la rétention de sûreté. Elle modifiait ensuite profondément la procédure applicable en cas d’irresponsabilité pénale pour des raisons psychiatriques.
S’il est fait appel de l’ordonnance du juge d’instruction constant l’irresponsabilité pénale, il est créé devant la chambre de l’instruction une sorte de mini-procès qui se déroule en audience publique. À cette occasion, le mis en examen peut être entendu si son état le permet, ainsi que des témoins, les experts et la ou les parties civiles. La chambre de l’instruction, si elle confirme l’irresponsabilité, peut ordonner des mesures de sûreté.
Quand le débat débouche sur la polémique, que la passion risque de l’emporter sur la raison, que la question de la folie fait tache d’huile, il est peut-être utile de s’intéresser aux ressorts de l’irresponsabilité : pourquoi ne juge-t-on pas les fous ?
On peut considérer que l’irresponsabilité pénale due à une maladie mentale, quelle qu’en soit la qualification – folie, démence, trouble psychique ou neuropsychique… – est à la fois un principe juridique fondamental, une base humaniste et une norme de civilisation.
Il est remarquable de constater que cette irresponsabilité n’a jamais été considérée comme une norme absolue mais comme un impératif qui demandait une appréciation délicate. La vieille loi de Marc-Aurèle est révélatrice. Elle envisageait déjà que la folie devait être discutée : elle pouvait être simulée et surtout elle pouvait être intermittente. Il pouvait exister des « intervalles de bon sens ».
Qu’il y ait des degrés dans la folie et conséquemment une appréciation nuancée de l’irresponsabilité n’est donc pas une idée contemporaine. Mais dès lors que la maladie mentale a pris le dessus et a aboli toute volonté propre, la règle est claire.
Ce qui fonde l’irresponsabilité, c’est l’absence de libre-arbitre. Le malade n’a plus de choix. Il est guidé par son délire ou sa souffrance. Il n’est plus lui-même. Il est un autre, étranger à ses actes. Or, la loi pénale est faite pour les hommes libres. On ne juge pas une maladie mentale, on la soigne. Le fou est victime de sa maladie. Il faut donc le protéger.
Le malade mental est un citoyen avec ses droits et ses obligations. Tout citoyen a droit à un procès équitable. Or, le procès d’un fou ne peut l’être. Car pour être jugé, il faut avoir soi-même un peu de jugement. Il faut avoir la capacité d’expliquer ou simplement le raconter. Répondre, fournir des réponses sur son acte, tel est le sens premier et évident de la notion de responsabilité. Que peut dire un malade mental d’un acte commis en plein délire ? Raconter son délire, sans plus.
Si le malade mental n’est pas puni par la justice, son statut est très loin d’être un passeport pour une vie libre et sans contrainte.
Parmi toutes les affaires que j’ai instruites, il y a celle d’un homme dont la maladie mentale était avérée et qui avait entendu Dieu lui demander de tuer une femme – peu importe laquelle – pour sauver l’humanité. Une fois médicamenté, il a pu se souvenir de son délire, sans plus.
Quel étonnement de voir dans les très anciens textes comme l’ordonnance de 1670 cette idée pourtant évidente que les fous sont déjà assez punis par leur maladie. On peut parler d’humanisme ou de générosité. On pourrait simplement y voir la lucidité des siècles anciens sur ce qu’est réellement la maladie mentale : elle est avant tout une série de souffrances, une punition existentielle permanente.
Les troubles psychiatriques ont de multiples conséquences néfastes sur la vie quotidienne de ceux et celles qui en sont atteints. Il en résulte de multiples et lourds handicaps qui altèrent le fonctionnement social, familial et professionnel de la personne et font de sa vie une vaste douleur intime accentuée par le regard des autres. Pour qui refuse de regarder cette réalité humaine, il suffira de s’intéresser aux statistiques.
On constate aussi une surmortalité importante dans cette population. Les troubles mentaux occasionnent chaque année en France au moins 5000 morts par suicide en France, sans compter les seules tentatives. Ces malades sont extrêmement fragiles et meurent plus tôt que la moyenne. Ils sont bien plus du côté des victimes que des auteurs.
Cette vieille idée si simple est difficilement entendable aujourd’hui, à une époque où, pourtant, notre connaissance de la maladie mentale est censée être bien supérieure, le malade mental est le plus souvent présenté comme un être dangereux et potentiellement violent et le terme de victime est exclusivement réservé à celui qui subit l’infraction pénale.
Le traitement du malade psychiatrique ne peut donc être une double peine. Le droit pénal, comme son nom l’indique, instaure des punitions, même si, théoriquement, la définition moderne de la peine inclut bien d’autres objectifs, comme l’insertion ou la réinsertion.
Le fou doit être protégé, notamment contre des décisions irréfléchies ou injustes de la société et de la justice. Sa place n’est donc pas dans une prison qui n’est pas faite pour soigner, si ce n’est très subsidiairement et très maladroitement et qui génère de multiples pathologies propres.
Si le malade mental n’est pas puni par la justice, son statut, une fois déclarée l’irresponsabilité, est loin, très loin d’être un passeport pour une vie libre et sans contrainte. On prétend souvent qu’il échappe à la justice et que la société prend alors un risque inconsidéré. Rien de plus faux.
Les non-lieux autrefois, les décisions d’irresponsabilité aujourd’hui sont toujours suivis d’une mesure d’hospitalisation sans consentement prise par l’autorité administrative ou, aujourd’hui, par la juridiction qui a pris la décision. Or, le placement en hôpital psychiatrique est une mesure très contraignante. Elle l’est encore plus lorsque la personne est placée en Unité pour malades difficiles (UMD), dont le régime est extrêmement sévère et ressemble parfois en pire à un emprisonnement, si ce n’est que le patient ne sait jamais quand il en sortira.
Le préfet dispose pour l’instant d’un pouvoir souverain, sans même être obligé de se confirmer à l’avis des médecins. Et le juge judiciaire, pourtant gardien des libertés, ne semble pas pressé de s’en mêler. Certains patients restent ainsi hospitalisés des dizaines d’années, plus longtemps qu’ils n’auraient été détenus s’ils avaient été déclarés responsables. Certaines mesures, comme la contention et le placement à l’isolement, sont gravement attentatoires aux libertés.
Il a fallu d’ailleurs que le législateur intervienne pour éviter de nombreux abus constatés au sein des hôpitaux psychiatriques. Une loi du 14 décembre 2020, faisant suite à une décision du Conseil Constitutionnel, rappelant que le juge est gardien des libertés, a donné au juge judiciaire le pouvoir d’intervenir pour contrôler strictement ces mesures de contention et d’isolement.
Décider qu’une personne est irresponsable n’est donc pas faire preuve de faiblesse comme le prétendent certains, reprenant l’antienne ordinaire sur le laxisme de la justice, qui se heurte pourtant aux chiffres têtus de la répression et de la surpopulation pénitentiaire. Placer en hôpital psychiatrique et encore plus en UMD est l’équivalent d’une sanction lourde, parfois plus sévère qu’un emprisonnement.
Plusieurs facteurs expliquent le nouveau débat autour de l’irresponsabilité et les passions qu’il déchaîne : l’ignorance des réalités actuelles, la place grandissante mais ambiguë des victimes et les multiples crises que traversent les institutions concernées.
Il faut savoir que beaucoup d’affaires arrivent directement devant le tribunal correctionnel sans qu’aucune expertise ait été ordonnée.
Il est difficile de connaître en France la pratique judiciaire en matière d’irresponsabilité. Le nombre de non-lieux ou de décision d’irresponsabilité a-t-il tendance à augmenter ou à baisser ?
Le nombre de personnes ayant bénéficié de ces mesures est connu.
En 2018 on en comptait 326, en 2008, 169, en 1998, 211, en 1992, 493 et en 1989, 611. Il est difficile de donner de ces chiffres une interprétation quelconque, si ce n’est que les changements législatifs ne semblent pas avoir eu beaucoup d’effet sur la pratique. Il faut en effet avoir à l’esprit que le nombre d’informations ouvertes a fortement chuté ces dernières décennies. En 1991, 51 937 informations étaient ouvertes. Le flux s’est ensuite constamment tari, passant de 44 554 dossiers confiés aux juges d’instruction en 1995 à 17 174 en 2019.
L’incertitude est encore plus grande quand on sait que l’immense majorité des affaires qui mettent en jeu la responsabilité psychiatrique ne vont pas chez le juge d’instruction mais sont classées sans suite par le procureur de la République, au vu d’un examen psychiatrique effectué pendant la garde à vue. Le motif officiel est « état mental déficient ».
Les chiffres fournis dans le rapport parlementaire de 2021 sont étonnants. Le nombre de ces classements sans suite passe de 6195 en 2012 (première année où cette donnée est répertoriée) à 13 495 en 2018. Ces statistiques sont inexploitables. « On ne sait à peu près rien sur les 13 495 affaires classées par le parquet en 2018 » reconnaît le rapport parlementaire. Tout au plus peut-on supposer que ces affaires sont des dossiers correctionnels qui intéressent peu l’opinion publique et ne mobilisent pas grand monde.
Il faut aussi savoir que beaucoup d’affaires arrivent directement devant le tribunal correctionnel (notamment en comparution immédiate) sans qu’aucune expertise ait été ordonnée. Ce qui explique en partie le nombre considérable de malades mentaux qui se retrouvent en prison.
Il est donc impossible de tenter une analyse quelconque de l’attitude de la justice face au problème de l’irresponsabilité pénale. Face à tant d’inconnues, on peut se demander comment il est possible de légiférer correctement.
Impossible de parler de l’irresponsabilité sans parler des victimes. Celles-ci, après avoir été les grandes oubliées de la justice, ont bénéficié depuis quelques dizaines d’années d’une certaine sollicitude des pouvoirs publics. À juste titre, leurs droits se sont étendus, au grand dam de tous ceux qui fantasment sur « une société de victimes », une « société victimaire » ou une « ère victimaire ».
Non seulement leurs droits se sont accrus, mais aussi leur influence sur l’ensemble de la société et notamment sur la classe politique et le législateur. Il a été enfin possible d’entendre de multiples souffrances qu’on préférait taire ou ignorer. Inévitablement, ces nouvelles voix ont dénoncé, le plus souvent avec raison, l’inaction des pouvoirs publics mais aussi de la justice.
Il ne s’agit pas seulement des personnes physiques ou de leurs proches mais de groupements sous forme d’associations ad hoc ou de groupes plus éphémères. La mobilisation, sous le coup de l’émotion et de la compassion, peut être beaucoup plus large sous forme de manifestation, de marche blanche ou d’actions de solidarité.
Cette force sociale nouvelle attire la convoitise. Les victimes sont devenues la proie de mouvements démagogiques et populistes qui trouvent ou essaient de trouver, sans le moindre scrupule, dans cette population mouvante mais très motivée un appui et un relais pour leurs propositions de plus en plus sécuritaires, au mépris parfois des libertés et des droits de l’homme.
Parmi ces critiques figure celle concernant les décisions d’irresponsabilité : on entend ainsi qu’on prive les victimes et leurs proches d’un procès, qu’on les empêche de faire leur deuil, que les juges font une nouvelle fois preuve de laxisme.
Peu osent dire que le procès n’est ni une thérapie ni le lieu d’une catharsis, pas plus qu’elle ne garantit une responsabilisation quelconque d’un malade mental bénéficiant d’une confrontation à la Loi.
Le procès doit être vu de façon beaucoup plus prosaïque. Ses effets sur les parties civiles et le prévenu ou l’accusé sont imprévisibles. Tout est possible. Les victimes peuvent s’en féliciter : avoir été entendues, avoir pu dire leur souffrance ou leur colère, avoir pu comprendre, au moins un peu, avoir pu être confrontées avec l’auteur et être présentes lors du prononcé de la condamnation… Le procès peut être à l’inverse le lieu d’une grande déception, voire d’une révolte face à ce qui est ressenti comme une injustice. Et si celui qui est accusé est un malade mental, même médicamenté, l’échange ne peut qu’être encore plus frustrant et décevant.
Pour celui qui est jugé, quel peut être l’effet du jugement ? Il y a fort longtemps comparaissait devant le tribunal correctionnel que je présidais un homme poursuivi pour la énième fois pour vol. Souffrant d’une profonde débilité, il avait évidemment échoué une nouvelle fois et avait été renvoyé devant le tribunal sans le moindre examen. Une expertise avait été ordonnée. Voici ce qu’en disait l’expert :
« M. N. ne nie pas les faits qui lui sont reprochés. Il peut à la limite en percevoir la dimension transgressive. Reste que le sens qu’il donne à son action est puéril. Le raisonnement est sans logique, pauvre et peu élaboré. Il est incapable d’assurer sa défense. Il garde une vision très anecdotique de ses antécédents judiciaires. Il se révèle incapable d’intérioriser la peine, la contrainte sociale comme toute expérience antérieure. Les évènements vécus ne prennent pas valeur d’exemple et n’entraînent pas de contrainte intérieure. Il vit dans l’instant et diffère difficilement la satisfaction d’un désir ou d’une pulsion. Toute entrave à cette satisfaction lui apparaît souvent comme directement persécutive. »
Une relaxe avait été décidée au regard de l’article 122-1. J’avais dû lui expliquer lentement ce qu’était une « relaxe ».
La maladie mentale éloigne du procès auquel le fou est encore plus étranger qu’un autre. Le passage dans une salle d’audience ne facilite en rien une prise de conscience, pas plus qu’une prise en charge thérapeutique.
Changer une loi quand toutes les institutions concernées sont en crise n’est pas un gage de réussite.
La justice connaît de multiples crises. Celle qui nous intéresse concerne son rôle face à la maladie mentale. Une des évolutions majeures de la dernière décennie est la place nouvelle que la loi lui a accordée depuis 2011 dans le contrôle de l’hospitalisation psychiatrique. Or, le juge judiciaire y participe avec une certaine frilosité, de peur d’être accusé de sortir de son rôle alors que sa mission, que le Conseil Constitutionnel lui rappelle en la matière, est de garantir les libertés.
À la frontière de la justice et de la psychiatrie, l’autre crise est celle de l’expertise.
Bien plus grave est la gestion du monde pénitentiaire. Les juges remplissent les prisons de personnes souffrant de lourdes maladies psychiatriques sans que cela dérange grand monde. Cette situation, installée depuis longtemps, ne peut que s’aggraver dans le climat sécuritaire actuel.
La psychiatrie, présentée aujourd’hui comme la grande malade de la santé publique en France, connaît une crise bien plus grave encore. Face à une demande des patients qui explose, le manque de moyens est criant et dénoncé depuis des années par le personnel soignant. Suroccupation des lits, saturation des centres médico-psychologiques, retards de prise en charge, méthodes managériales inadaptées, lassitude voire épuisement des soignants, sans compter les virulentes querelles d’idées sur ce que doit être la psychiatrie.
À la frontière de la justice et de la psychiatrie, l’autre crise est celle de l’expertise. Le nombre d’experts psychiatres ne cesse de diminuer. Les raisons de cette raréfaction sont connues depuis longtemps : ce travail est sous-payé alors qu’il exige un investissement important et une mobilisation croissante des psychiatres volontaires.
Le fait que la loi pénale ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement n’est en rien constitutif d’un « vide juridique » : la loi est bien là, et la chambre de l’instruction qui l’a appliquée dans l’affaire Traoré n’a été prise d’aucun vertige dans un arrêt longuement et clairement motivé.
La présidente de la commission des lois de l’Assemblée Nationale affirmait pour justifier une modification de la loi : « On ne peut pas juger les fous, en revanche, il faut bien décortiquer la responsabilité de chaque individu qui ne peut pas être exonéré du fait de son propre comportement coupable, consommation de stupéfiants ou autre. »
Décortiquer : telle est bien la mission de la justice et non celle de la loi, dont il faut rappeler la nature et la mission. La loi n’est pas magique et ne peut remplacer le juge.
Il suffirait d’augmenter les peines ou d’édicter des peines fixes ou des peines planchers pour dissuader les criminels, en évitant les aléas du juge ? Il suffirait de définir les différentes causes de la maladie mentale pour savoir avec certitude qui est responsable ou non, en s’épargnant les errements des juridictions ?
La loi est générale, la justice particulière. Le jugement ne se contente pas de viser un texte. Il entre dans des détails, dans les circonstances d’une vie à nulle autre pareille qui échappent par nature à une loi impersonnelle.
En prétendant entrer dans les arcanes des causes de folie, la loi se perdrait à tout coup. Elle serait soit ridicule, soit inutile, mais de toute façon dangereuse, risquant de pénaliser encore plus la maladie mentale. Rien de plus complexe que de déterminer les différents facteurs en jeu dans la genèse et le développement d’une psychose et dans le déclenchement du passage à l’acte. Quel législateur oserait prétendre imposer sa vision et son échelle des cheminements biologiques, génétiques, psychologiques, sociaux ou exotoxiques qui conduisent aux psychoses ?
Quand la science elle-même hésite, le législateur gagne à être modeste. La sagesse est donc d’en rester à l’état du droit. Le récent rapport parlementaire ne disait rien d’autre : « Le corpus juridique pris dans son ensemble (principes fondamentaux, dispositions législatives et réglementaires internes, jurisprudence constante…) est suffisamment riche pour permettre d’appréhender avec le plus de justesse possible la complexité des situations humaines et leur qualification pénale. »
Le débat sur l’irresponsabilité mérite donc mieux qu’une loi irresponsable rédigée à la va-vite pour des motifs électoraux. On ne réfléchit pas à la maladie mentale au pas de charge.
