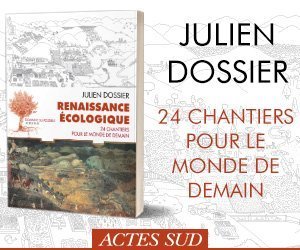James C. Scott : « Beaucoup de gens sont anarchistes sans le savoir »
James C. Scott est professeur émérite de science politique et d’anthropologie à l’université de Yale, aux États-Unis. Il nous répond depuis sa ferme du Connecticut, où il vient de s’occuper de ses vaches, des Scottish Highlands. Une façon de maintenir un lien avec son sujet d’étude depuis des décennies, les sociétés paysannes et les différentes formes de résistance à l’État qu’elles ont pu mettre en œuvre. L’anthropologue et politiste y a consacré de nombreux livres, dont quatre ont été traduits en français : La Domination et les arts de la résistance (Amsterdam, 2009), Zomia ou l’art de ne pas être gouverné (Seuil, 2013), Petit Éloge de l’anarchisme (Lux, 2013) et le dernier Homo Domesticus : Une histoire profonde des premiers États publié en début d’année aux éditions La Découverte. James C. Scott y remet en cause le récit canonique qui fait de la domestication des plantes et des animaux le fondement de la civilisation, dont la forme la plus aboutie serait l’État. Il inverse la proposition en s’interrogeant d’une manière faussement naïve, et si ce n’était pas l’homme qui avait domestiqué veaux, vaches et cochons, mais l’inverse ? Dans cette perspective anarchiste, c’est l’homme qui devient une espèce domestiquée par l’État. RB
On vous présente souvent comme un anthropologue anarchiste, comme votre compatriote David Graeber, mais votre premier domaine de recherche c’est la science politique. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et nous dire comment vous avez glissé vers l’anthropologie ?
C’est vrai que quelqu’un qui ne connaitrait pas mon parcours, et qui lirait mes livres aujourd’hui, pourrait penser que je suis anthropologue. En réalité, j’ai fait des études de science politique, jusqu’au doctorat que j’ai obtenu à l’université de Yale… C’est en fait par opportunité et à travers la pratique que mes recherches ont pris une dimension anthropologique. J’ai commencé à enseigner l’histoire et la politique de l’Asie du Sud-Est, la zone géographique dans laquelle je me suis spécialisé, à l’université du Wisconsin-Madison au moment de la guerre du Vietnam. Or, c’était l’un des lieux importants de la mobilisation politique à l’époque, et je me suis retrouvé à passer la plus grande partie de mes deux premières années dans les protestations contre cette guerre. Le cours que je donnais alors portait sur les révolutions paysannes. C’est à ce moment que j’ai décidé de consacrer ma carrière à l’étude de la paysannerie, en partant du constat simple qu’il s’agissait de la classe la plus importante en nombre de l’histoire. Si le développement ne parvenait pas à changer la vie des paysans, alors on pouvait envoyer le développement au diable. Mais je ne voulais pas me contenter d’une approche purement intellectuelle, pour consacrer ma vie à ce sujet il m’a semblé indispensable de vivre leur vie pendant un certain temps, d’en faire l’expérience pour en avoir une connaissance intime. Pour comprendre les paysans, et spécifiquement ceux des villages d’Asie du Sud-Est, j’ai donc vécu pendant deux ans dans un village de cultivateurs de riz. Ça a donné lieu à un livre, Weapons of the weak : Everyday Forms of Peasant Resistance (Yale University Press), non traduit en Français, qui tentait de comprendre ce que j’appelais la « résistance paysanne ». Ce fut surtout été l’origine de l’approche anthropologique de mes recherches.
Vous avez toujours une expérience de l’agriculture puisque vous avez une ferme, ce qui n’est pas sans conséquences sur votre pratique académique…
Oui on pourrait dire ça, mais je ne voudrais pas exagérer mes succès en tant que fermier. J’ai élevé des moutons pendant plus de vingt ans, un troupeau d’une trentaine de femelles et je vends peut-être quarante agneaux par an, principalement à des Italiens ou des Grecs au moment de Pâques. C’est à peu près le seul marché pour l’agneau ici. Je tonds également mes moutons et ceux de mes voisins, mais je pense que si je devais en vivre, je serai vite en faillite. Heureusement, j’ai mon métier d’enseignant.
Vous n’avez pas répondu à propos du qualificatif « anarchiste » souvent attribué à vos travaux, vous avez d’ailleurs signé un Petit éloge de l’anarchisme…
Ma relation à l’anarchisme tient d’abord à un constat, tiré de mon enseignement de l’histoire des révolutions. Au fil de mes recherches, j’ai réalisé que la plupart des révolutions finissaient par déboucher sur la création d’un État encore plus fort, plus oppressif que celui qui venait d’être éliminé. Ce fut mon premier pas vers l’anarchisme, simplement en étudiant les révolutions. J’ai alors approfondi mes lectures sur la paysannerie, des historiens français comme Marc Bloch, Emmanuel Le Roy Ladurie ou Maurice Aghulon m’ont beaucoup influencé. En anglais, le livre auquel vous faites référence s’intitule Two cheers for anarchism, c’est un jeu de mot difficile à traduire, qui fait référence à l’expression « three cheers for… », lorsque on veut acclamer quelqu’un ou quelque chose. Passer de trois à deux « acclamations », c’était une façon de mettre un bémol à mon approbation de l’anarchisme. Dans cette série de textes sur la façon dont les anarchistes envisagent la coopération sans hiérarchie, je tente quelques incursions dans des processus politiques qui sont mal connus et mal compris. C’est donc un hommage aux perspectives ouvertes par la pensée anarchiste, sans marquer une adhésion complète. Pour être parfaitement honnête, je ne pense pas probable qu’on puisse un jour se débarrasser de l’État comme forme de gouvernement. À partir de là, notre rôle c’est d’essayer de domestiquer l’État, de l’apprivoiser si vous voulez. Je suis assez pessimiste quant à notre capacité à y parvenir, mais quoi qu’il en soit je ne vois pas d’autre option que d’en passer par des formes démocratiques d’État.
C’est ce pessimisme qui oriente vos travaux vers l’étude de ce que vous appelez « l’infrapolitique », les petites actions dont disposent les plus faibles pour marquer leur opposition et peut être limiter le pouvoir des États sur leur vie ?
C’est à peu près ça, parce qu’en réalité beaucoup de gens sont anarchistes sans le savoir, sans même connaitre le mot ou comprendre leur comportement dans ce sens. L’infrapolitique, c’est un concept pour essayer de comprendre ce que peut être la résistance politique quand il n’y a pas la possibilité de s’organiser publiquement, de créer des syndicats, de manifester. Je m’intéresse aux époques et aux espaces géographiques où l’action politique ouverte est dangereuse. Dans ces cas-là, on voit se développer toute une série d’actions, de comportements, qui permettent d’agir politiquement sans se mettre trop en danger. C’est même, on peut dire, la forme la plus répandue d’action politique dans l’histoire, bien plus que les révolutions que j’ai étudiées. Par exemple, plutôt que de me pencher sur les invasions de terres illégales par les mouvements des « sans terre », pour reprendre ce qui avait été accaparé au détriment des paysans, je me suis penché sur des formes traditionnelles d’occupation, de « squat ». C’est une façon d’affirmer la propriété réelle sur une terre par la pratique, l’exploitation de facto. Avec des pratiques d’évitement, de fuite, puis de retour. J’ai pu par la suite, rapprocher ces actions du braconnage ou de la désertion, autant de façons de mener des actions individuelles, infrapolitiques, s’exposer, sans se mettre en danger outre mesure en s’exposant facilement aux représailles. Avec un résultat à peu près similaire au final. Si l’on pense à la désertion, la version ouverte, exposée, serait la mutinerie, qui mène presque inévitablement au peloton d’exécution. La désertion offre plus de chances de s’en sortir. À l’époque napoléonienne on peut penser aux auto-mutilations que s’infligeaient ceux qui ne voulaient pas être enrôlés dans l’armée. C’est bien une forme de résistance.
Ce concept, vous allez particulièrement le développer dans Zomia ou l’art de ne pas être gouverné (Seuil), dans lequel vous proposez une étude de la résistance des plus faibles à l’État, afin aussi de déconstruire un certain nombre d’idées reçues sur niveau de développement, de civilisation de ces peuples qui se tiennent à la marge.
Comme je le disais, ma formation c’est la science politique, et je me suis spécialisé dans l’Asie du Sud-Est. Mes premières recherches m’ont amenées en Malaisie, j’ai aussi passé beaucoup de temps en Birmanie, dont je parle la langue — j’espère d’ailleurs travailler bientôt sur la rivière Ayeyarwady. C’est vraiment la zone du monde que je connais le mieux, sur laquelle j’ai donné des cours pendant des années. Zomia, c’est une tentative de comprendre de manière un peu différente ces peuples des montagnes du Sud-Est asiatique, qui refusent toute autorité étatique, et qui ont toujours été regardés à cause de cela comme composés d’êtres primitifs, rétifs à la civilisation. La preuve, ils ne se sont jamais donné le mal de descendre dans la vallée pour fonder une civilisation. Ce que j’ai montré, en prenant une approche sur le long terme qui s’étalait sur 2000 ans d’histoire, c’est que ces gens ont en réalité fui les États des vallées à cause des impôts, des maladies, de l’oppression, des guerres… Je dois ici rendre hommage à un autre intellectuel français, l’anthropologue Pierre Clastres dont l’ouvrage La Société contre l’État (Éditions de Minuit) m’a beaucoup inspiré. Son terrain se situait en Amérique du Sud, mais il montrait de la même façon comment les indiens Guarani ou les Yanomami, considérés comme étant restés à l’âge de pierre, incapables de découvrir l’agriculture, avaient en réalité fuit les colonies espagnoles à cause des maladies et du travail forcé. Ils ont donc fait le choix d’une vie de chasseur cueilleurs – plus qu’ils ne subissent cet situation – pour rester éloignés de l’État oppressif. Ce n’est pas qu’ils soient incapables de planter et de cultiver leur subsistance, ils préfèrent simplement une forme de vie plus mobile afin de rester éloignés des dangers que représente l’État.
Dans votre dernier livre Homo Domesticus : Une histoire profonde des premiers États (La Découverte) vous prenez une focale encore plus grande, en vous penchant sur les dix millénaires qui ont précédé notre ère, dans une région considérée comme le berceau de la civilisation agraire, la Mésopotamie. Avec, encore une fois, le désir de combattre les idées reçues, en l’occurrence l’idée selon laquelle l’organisation en État serait la marque du progrès. Rien de moins évident à vous lire… Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
À l’origine de ce livre, il y a une commande. Je venais juste de finir Zomia quand on m’a demandé de donner une conférence à Harvard, les Tanner lectures. C’est une conférence très prestigieuse, et très bien payée, j’avais donc l’intention d’accepter mais cela tombait mal car j’avais aussi envie de profiter de cette période qui suit la fin d’un livre, quand on peut enfin lire ce qu’on veut, sans obligations. Je ne voulais donc pas me lancer dans un projet trop important. J’ai cherché ce que je pourrais faire en deux trois mois et qui serait intéressant. Il se trouve que j’enseigne depuis vingt-cinq ans un cours chaque année à Yale sur l’analyse comparative des sociétés agraires. Nous sommes trois ou quatre professeurs à nous succéder pour donner ce cours, mais en général c’est moi qui me charge de la leçon d’ouverture sur la domestication des animaux, des plantes, et leur rôle dans la création des premiers États. Or, il me semblait que ma leçon était un peu datée, qu’elle ne prenait pas en compte toutes les découvertes de ces deux dernières décennies. J’ai donc décidé de reprendre la littérature en histoire, en archéologie, sur la Mésopotamie des premiers âges, afin de voir ce qu’elle disait du processus de domestication et de création des premiers États. Et là ce fut un choc. Je me suis rendu compte qu’une bonne partie de ce que j’avais enseigné ces dernières années était tout simplement faux. Le « récit canonique », sur lequel je reviens dans Homo Domesticus, qui fait de la domestication des plantes la condition de la sédentarisation, et donc de l’accroissement démographique, des loisirs parce qu’enfin il était possible d’avoir de la nourriture à disposition, et au final la condition de la création des civilisations, tout ce récit qu’on enseigne à nos enfants dans les écoles et auquel j’adhérais sans y réfléchir, s’est révélé tout simplement faux, et dans des proportions considérables. La conférence que j’ai donné à Harvard racontait mon étonnement, mes erreurs. Et j’ai ensuite passé les trois années suivantes essentiellement à lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet, que ce soient des travaux d’archéologues ou de scientifiques sur la domestication et l’étude de l’ancienne Mésopotamie puisque c’est là que l’État est né. Ce livre est donc le résultat d’une curiosité d’amateur et d’intrus dans un champ qui n’est pas le mien, l’histoire des sociétés anciennes. J’ai pris pour parti d’être un reporter consciencieux et honnête de tout ce qu’on sait maintenant et qui perturbe radicalement ce qu’on pense savoir de l’origine de la civilisation.
Une de ces idées, c’est donc celle qui pense l’État comme le résultat inévitable de la marche vers le progrès, ce que vous montrez c’est qu’il entre dans leur formation une grande part de coercition.
C’est vrai. Les gens ont compris depuis longtemps que l’agriculture et le choix d’une vie sédentaire impliquaient en réalité une dose énorme de travail pour survivre, si on compare à ce que rapporte la chasse et la cueillette dans un environnement abondant. C’est là un point important, et je dois beaucoup en la matière à l’archéologue Jennifer Pournelle qui a montré que la Mésopotamie d’il y a 8000 ans était en fait une grande zone humide. Donc le postulat sur lequel on a fondé le récit canonique que j’évoquais à l’instant était faux puisqu’on se pensait la région telle qu’elle est aujourd’hui, une zone aride qu’il fallait irriguer pour la cultiver et survivre. La maîtrise de l’eau et des techniques hydrauliques étant considéré comme un élément essentiel de la création des États. Mais ce qu’on sait désormais, c’est qu’en fait cette région était un vrai paradis humide à cette période qui s’étend entre 6000 et 4000 ans avant notre ère. On y trouvait des villes avec des populations entre 2000 et 4000 personnes, sans rois, vivant de façon quasi sédentaire mais sans agriculture. En fait, tout montre qu’homo sapiens savait domestiquer les plantes 4000 ans avant de commencer à les cultiver de façon massive. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que cela n’avait aucun intérêt dans un écosystème comme celui de la Mésopotamie d’alors. Je n’en parle pas beaucoup dans le livre, mais on peut faire le même constat pour les Maya, Teotihuacan près de Mexico, l’estuaire du Fleuve Jaune ou la vallée du Nil… autant de zones humides qui ont vu naitre des civilisations importantes.
C’est là que la culture du « grain » entre en jeu… le titre original de votre livre est Against the Grain, c’est bien que vous donnez au blé, à l’orge, au riz etc. une importance fondamentale dans ce processus.
Le premier problème des États dans ces temps anciens était d’assembler, et de comprimer pourrait-on dire, une concentration humaine jamais égalée dans l’histoire. Et le seul endroit où cela soit possible, c’est dans les plaines inondables où les sols sont particulièrement fertiles. Des lieux comme la vallée du Nil où l’on trouve de la nourriture en abondance et une population rassemblée de façon suffisamment dense pour pouvoir être prélevée, soumise au travail obligatoire, à la conscription… Mais ce que j’essaie de montrer, en poussant l’argument un cran plus loin, c’est que la seule ressource qu’il soit facile alors de taxer ce sont les céréales. En l’occurrence, le blé et l’orge. De tous les aliments de base possibles, les grains tirés de ces céréales sont les plus aptes à être taxés. Et l’on voit peu à peu se dessiner ce schéma de la civilisation assimilée à l’État, lui-même assimilé à la culture des céréales. C’est le cas par exemple dans la Rome antique où l’on tirait beaucoup de fierté de la consommation de blé associée à une vie civilisée.
Peut-être aussi parce que le fait de se sédentariser, de recourir à l’agriculture pour survivre est le choix le plus efficace et le plus rationnel…
Justement non ! C’est l’idée qu’on retrouve dans le récit canonique que je veux réfuter. Pensez à ce que je disais sur l’abondance qui règne en Mésopotamie : on trouve des poissons, des oiseaux, la migration des gazelles pouvait assurer à un chasseur habile et placé au bon endroit de rassembler en quelques semaines assez de viande pour un an, il était aussi possible de cueillir du blé sauvage. Les faits sont là : quand des archéologues découvrent des squelettes de groupes de chasseurs cueilleurs, et qu’ils les comparent aux squelettes connus de gens vivant dans des sociétés céréalières, les premiers sont en bien meilleure santé, leurs os ne montrent pas les mêmes marques de carence nutritionnelle, d’interruption de croissance. Évidemment, ce choix de planter et de cultiver des céréales serait le meilleur là où n’existe aucun autre moyen de subsistance. Mais ce n’était pas le cas en Mésopotamie. Résultat, les gens fuyaient pour éviter de payer les taxes, d’être enrôlés dans les armées, de devoir s’acquitter des corvées. On le sait grâce aux nombreuses lois qui sont alors décrétées pour condamner les fuyards. On comprend mieux au passage pourquoi les guerres d’alors sont essentiellement des guerres de capture, à l’issue desquelles le butin le plus important était ces populations que l’on pouvait ramener chez soi pour les installer. On peut donc conclure que conserver sa population était le problème numéro un des États primitifs, et que la coercition s’est tout de suite imposée comme un mode de gouvernance.
Ces guerre de capture que vous évoquez introduisent dans votre raisonnement la question de la place des femmes et des esclaves dans l’histoire que vous retracez…
C’est d’ailleurs un point que j’aurais sans doute dû développer davantage. Au cours de ces guerres de capture, le prix de plus grande valeur était sans conteste les femmes. En plus d’être une force de travail qui aide à accroitre le volume des récoltes, c’est une force reproductive. Les hommes qui étaient capturés étaient cantonnés à un travail de forçat. Les femmes et les enfants pouvaient avoir bien d’autres usages. Un exemple qui peut sembler trivial mais qui est en fait très significatif, c’est l’usage répandu à Rome du prénom Barbara qui était donné aux esclaves affranchies devenues citoyennes.
Et qu’est-ce que ça nous dit d’aujourd’hui, de la façon dont cette forme minoritaire d’organisation qu’est l’État est devenue majoritaire ?
Vous avez remarqué que dans mon livre, je prends bien garde de ne pas tirer de conclusions trop actuelles, par exemple sur le rapport entre la civilisation agraire et le réchauffement climatique, ou sur le rapport à l’État aujourd’hui. C’était important pour moi de limiter ma réflexion à la remise en cause du récit traditionnel et dominant sur l’origine des civilisations, et de laisser les lecteurs tirer leurs propres conclusions. Pour parler d’aujourd’hui, et ne pas éviter votre question, je me référerai à Vaclav Smil, un chercheur et analyste politique canadien d’origine tchèque qui s’intéresse aux questions écologiques. Il a mené une recherche statistique qui m’obsède depuis plusieurs mois maintenant, consistant à essayer de calculer le ratio entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. C’est un exercice statistique complètement fou. Il est parvenu à la conclusion qu’aujourd’hui, le rapport entre la viande d’animaux sauvages et la viande d’animaux domestiques est de 1 à 9. Même s’il se trompe sur ce chiffre, la tendance qu’il indique permet de se rendre compte de l’impact de la domestication, et de la place laissée au monde sauvage. Nous avons remplacé peu à peu ce monde sauvage par un monde domestiqué, pour notre plaisir et notre régime alimentaire. D’ailleurs, si on ajoute les humains à ce ratio entre le sauvage et le domestique, on passe à un rapport de 1 à 80 ! Je trouve assez stimulant de se demander ce que serait ce chiffre si on faisait le même exercice pour les plantes. On se rendrait certainement compte que la faune et la flore ont été peu à peu remplacées par nos propres créations. Quel est la conséquence, je ne saurais le dire…
Pour en revenir au passé que vous étudiez, l’idée de domus développé dans Homo Domesticus vient justement définir ce lieu de cohabitation entre l’homme, les animaux et les plantes… et met finalement la question de la domestication au centre de la vie politique.
Exactement, il me semble qu’arrivés à ce stade de notre raisonnement, il faut se poser la question de la responsabilité d’homo sapiens : dans quelle mesure ses obligations sont-elles davantage envers la vie sauvage qu’envers les animaux domestiques ? Je n’ai pas la réponse à cette question, mais elle est assurément primordiale. J’ai deux vaches, des Highlands que j’ai nommées Dundee et Fife, dont je m’occupais avant qu’on ne se parle. On pourrait dire d’un côté que ces vaches, cette race, on les a créées et donc qu’elles sont notre propriété, et qu’on peut donc en faire ce qu’on veut. D’un autre côté, elles n’ont pas demandé à être là, on est responsable de leur présence, on leur doit donc de les traiter avec soin. Il me semble qu’à partir de ce moment-là, la question est de savoir quelles sont nos obligations vis-à-vis de la vie sauvage… et c’est une question passionnante sur le plan philosophique. Je dois préciser ici que je ne suis pas vegan. J’essaie d’être très attentif à ce que je mange, à m’assurer que les animaux qui atterrissent dans mon assiette ont vécu une vie « reconnaissable », c’est-à-dire qu’ils ont vécu comme doit le faire un animal de leur espèce. La production industrielle des poulets par exemple me semble être aujourd’hui l’une des pires insultes au vivant. Je n’ai rien contre le fait de manger de la viande, mais en ce qui concerne les animaux domestiques il me semble qu’on leur doit une vie qui soit la plus « naturelle » possible compte tenu des circonstances. Tout ce qu’on fait aujourd’hui, confiner les poulets dans des cages si petites qu’ils ne peuvent plus bouger par exemple, c’est une torture qui suscite à juste titre l’indignation. J’en profite pour signaler le travail d’un de mes étudiants, Timothy Pachirat, qui s’intéressait justement à la question de savoir ce que ça fait de tuer toute la journée des animaux pour vivre. Il a mené un travail ethnographique passionnant, en se faisant embaucher dans un abattoir d’Omaha (Nebraska), où il a tenu plusieurs postes y compris à l’étage où les animaux sont tués. Il en a tiré un livre magnifique, non traduit en Français, intitulé Every 12 seconds (Yale University Press), dans lequel il part de cette expérience pour explorer la production industrielle de viande mais aussi comment, en tant que société, nous rendons possible ce type de travail violent tout en le cachant car trop répugnant pour être regardé en face. Il propose d’ailleurs à la fin du livre que les abattoirs soient construits avec des murs en verre, afin que chacun puisse voir ce qui se passe avant que la viande n’arrive sur sa table.
Pour finir j’aimerais vous interroger sur la résistance à l’État telle qu’elle se manifeste aujourd’hui, aux États-Unis avec l’élection de Donald Trump, en France dans le mouvement des « gilet jaunes ». Quel regard portez-vous sur ces phénomènes ?
Je vais être très prudent pour vous répondre car, comme le dit Clint Eastwood dans une réplique célèbre « A man’s got to know his limitations », il faut connaitre ses propres limites. Mais concernant Trump, j’appellerais volontiers cela du fascisme à caractéristiques américaines. Il y a certainement quelque chose qui se joue avec les élites technocratiques, l’influence des plus fortunés et des lobbies. Thomas Piketty nous a montré l’importance de l’accroissement des inégalités, et il me semble que les systèmes politiques démocratiques occidentaux ont été profondément corrompus par ces différents facteurs. La France est probablement à ce titre l’un des rares pays qui a conservé un semblant d’État providence et où on trouve des gens qui se battent pour le défendre. Bien sûr le paradoxe c’est qu’on trouve aujourd’hui aux États-Unis une critique de l’État dans la bouche des plus démunis, des électeurs de Trump. Mais il me semble, si on fait un peu de science politique, qu’il est important de regarder les choses sur le long terme et de remonter à la seconde élection de Barack Obama. Si on regarde les zones où les Démocrates ont fait leurs pires scores de l’histoire en 2012, où les Républicains ont gagné des voix malgré la victoire d’Obama à l’élection présidentielle, ce sont les zones qui ont été laissées pour compte, en arrière du progrès depuis ces trente dernières années. Je parle des Appalaches, de la Pennsylvanie occidentale, de la Virginie occidentale, du Missouri, de l’Arkansas, du Tennessee, du Kentucky, de l’Oklahoma… des États qui par ailleurs sont massivement Blancs. La vie de ces gens a été tellement ravagée qu’ils cherchaient juste ce qu’on appelle aux États-Unis une « wrecking ball », un boulet de démolition, et c’est ce que représente Trump. L’intelligentsia, dont je fais partie, a cru à chaque fois que Trump provoquait un nouveau scandale, prenait une décision atroce, absurde ou extravagante, que s’en était fini de lui. À chaque fois on s’est trompé car en réalité, pire était sa conduite, meilleure était son travail de sape pour lequel il a été élu. Bien sûr, l’aile droite du parti Républicain en profite pour avancer ses réformes, défaire le peu qu’il reste des protections sociales, des lois écologiques, s’en prendre aux migrants… Mais tout cela est imputable selon moi à l’échec répété des démocrates à défendre les maigres espoirs, les aspirations de ceux qui constituaient leur base politique.
Cet entretien a été publié pour la première fois le 9 mars 2019 sur AOC.