Le « refus du travail » : une idée reçue qui fait diversion
Le travail, au sens d’emploi salarié, a une place centrale dans les sociétés post-industrielles comme la France. Il est ainsi au cœur de l’action publique et des discours politico-médiatiques. À ce titre, différentes « notions » se sont succédées dans l’actualité récente du travail, suscitant de vifs débats. Au moins trois méritent attention, en ce qu’elles marquent une certaine convergence idéologique.
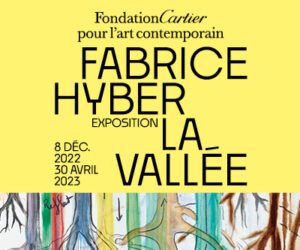
D’abord, en début d’année 2022, ce fut la « grande démission ». Venue des États-Unis, cette expression traduit les démissions en masse de la part des salarié.es post Covid-19. Ce phénomène menacerait de se produire en France et nécessiterait de redonner du « sens au travail », qui serait en perdition. À l’approche de l’été, c’était ensuite au tour de la « pénurie de main d’œuvre » de faire l’actualité, continuant à alimenter les discours sur les emplois « vacants » ou « non pourvus ». Depuis la rentrée, c’est enfin le « quiet quitting » (« démission silencieuse »), désignant des « mercenaires » ou « désengagé[e]s » au travail (plus exactement ne souhaitant pas travailler au-delà de ce qui est inscrit dans leur fiche de poste).
Faire du bruit à partir de (presque) rien
Il est remarquable que ces trois notions ne soient pas objectivées scientifiquement. D’une part, la « grande démission » n’a pas eu lieu en France. Et la hausse relative des démissions observées est un phénomène classique, car cyclique sur le marché de l’emploi, observable à l’occasion des reprises économiques. D’autre part, la « démission silencieuse » n’a rien de nouveau – pensons aux « freinages » dans l’industrie du XIXème siècle. Elle est également très difficilement quantifiable, si tant est qu’elle puisse l’être. Et pour cause : elle recouvre une diversité de pratiques et d’interprétations qui ne renvoient pas forcément à des personnes en désamour avec le travail. Par exemple, elles peuvent être très investies mais vouloir récupérer leur enfant à 18h et faire leur part de travail domest
