La fable désastreuse de la « santé culturelle »
Elle file à toute allure entre les lignes de discours ministériels, de propos diffusés dans et par de nombreuses associations culturelles, voire au sein de dossiers de conseillers municipaux engagés dans l’action culturelle. « Elle » ? Rien d’autre que l’expression « santé culturelle ». Elle est associée à des compléments : « de la population » ou des « citoyennes et citoyens », voire des « habitantes et des habitants », etc. Elle est cependant moins générale que ces compléments ne le laissent supposer.
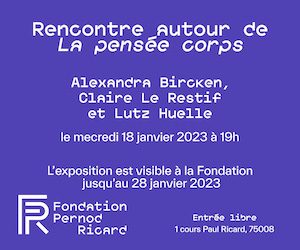
En effet, elle est spécifiquement appliquée à l’exécution d’une distinction interne à la population, sur une partie de laquelle elle incite à entreprendre des actions culturelles différenciées. Cette distinction repose sur l’appréciation de la « bonne » ou de la « mauvaise » santé culturelle des individus. Elle distribue ainsi les citoyennes et les citoyens en catégories dont les extrêmes regroupent les « populations en bonne santé culturelle » et les populations stigmatisées « en mauvaise santé culturelle », sachant que l’établissement d’une moyenne entre ces extrêmes à appliquer au corps politique ne ferait rien d’autre que dissimuler l’antithèse.
Cette expression, ainsi que les discours qui la légitiment et les pratiques qu’elle assigne, notamment sous forme d’un kit mis à disposition des professionnels de la culture, est récente dans le champ de la culture et dans les usages des opérateurs de la culture. Elle a sans doute pris le temps de germer avant d’être érigée en fétiche parce qu’elle donne sens à des pratiques pédagogiques. Au demeurant désormais adossée aux travaux d’une psychanalyste, Sophie Marinopoulos, dorénavant égérie des politiques interministérielles de l’éveil artistique et culturel, grâce à son dessein de concevoir et déployer une « stratégie nationale pour la Santé Culturelle », laquelle viserait d’abord à « Promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de la naissance à trois ans dans le lien à son parent », elle
