La (très) longue histoire des retraites
En avril 2019, Emmanuel Macron jugeait « hypocrite » le report de l’âge de départ à la retraite. Trois ans plus tard, il s’agit de la mesure phare du projet porté par Élisabeth Borne. Celui-ci s’inscrit dans une dynamique de plus long terme de dégradation des droits à la retraite. Le mouvement social qui s’annonce est l’occasion de revenir sur l’histoire conflictuelle du système de retraites français[1].
Celui-ci repose sur le principe de la répartition : des cotisations sont prélevées sur les salaires des actifs, afin de financer les pensions des retraités. L’OCDE note en 2021 que « le système de retraite français offre une bonne protection qui se traduit par un revenu disponible moyen élevé pour les plus de 65 ans en comparaison internationale »[2].
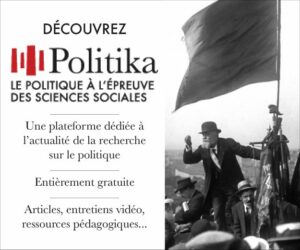
Si ce système de retraite est aussi ambitieux, c’est en grande partie parce qu’il est issu d’une longue histoire de conquêtes sociales[3]. La retraite apparaît comme un objet historique complexe qui s’inscrit dans des dynamiques de longue durée. Des dispositifs extrêmement variés, aux conceptions parfois diamétralement opposées, ont vu le jour au cours des derniers siècles afin de prendre en charge la question du risque vieillesse. Le système actuel porte les traces de cette histoire, dont la généalogie peut remonter au XVe siècle.
L’Ancien régime et la Révolution : du fait du prince au droit
Contrairement à une prénotion courante, les historiens ont montré que le Moyen Âge n’est pas un monde de jeunes. Les « vieux » y sont nombreux et jouent un rôle important[4] . La notion de vieillesse se comprend alors comme le synonyme d’impotence physique. Lorsque le greffier du Parlement Nicolas de Baye, âgé de 52 ans, n’arrive plus à lire les registres du tribunal sans lunettes, Charles VI lui propose de terminer sa carrière en tant que juge[5]. Dans les administrations de l’État central, c’est aux alentours de 60 ans qu’on clôt les carrières. Aux jeunes le travail, aux vieux le repos ; ce principe semble s’établir à
