L’Hétérocamérisme : une refondation du parlementarisme
Où réside la légitimité démocratique, quand un gouvernement fait adopter en toute légalité, mais par des dispositifs décriés, une réforme rejetée par la grande majorité de la population et des corps intermédiaires, qui s’y opposent par tous les moyens de la lutte sociale ? À l’évidence, une conception purement formelle de la démocratie peine à convaincre : les procédures, mêmes légales et constitutionnelles, ne sont en principe que des moyens d’expression de la volonté majoritaire des citoyens… ce qu’elles ne sont à l’évidence plus, notamment du fait de la confusion des motifs de vote qui caractérise selon nous le régime actuel. Vote-t-on au second tour de la présidentielle pour un programme incluant une réforme des retraites, ou pour faire barrage à une autre candidature ? Vote-t-on à l’Assemblée pour adopter cette réforme ou pour maintenir en place un gouvernement et éviter ainsi la dissolution ? Au fond, que veut-on quand on vote, et comment nos institutions traduisent-elles cette volonté ?
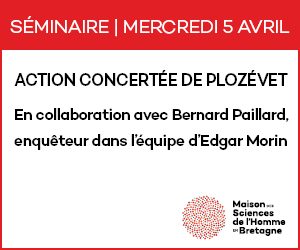
Le diagnostic de la crise de la démocratie est aujourd’hui largement partagé[1], sur fond de montée de l’abstention, d’indices de confiance catastrophiquement et durablement bas dans les institutions comme l’Assemblée nationale[2], de radicalisation des mouvements sociaux et de leur répression policière, de marginalisation des partis politiques traditionnels au profit de mouvements populistes de droite, de gauche et du centre formés autour d’une personnalité charismatique, etc. Longtemps considérée comme un débat clos, la démocratie se révèle être un chantier à rouvrir de fond en comble, car elle souffre selon Pierre-Henri Tavoillot à la fois « d’une terrible crise de la représentation, d’une grave impuissance publique et d’un profond déficit de sens »[3].
C’est au premier de ces problèmes que nous voulons ici nous attaquer, car les carences de la démocratie représentative nous semblent ne pouvoir être palliées par aucune forme de démocratie participative[4] (même si
