La critique de l’antiracisme devenue folle
Depuis le début des années 2000, la critique de l’antiracisme, auparavant généralement située à l’extrême droite, se développe dans des milieux qui insistent sur l’importance de l’appartenance à la nation et, corrélativement, exaltent les valeurs de la République.
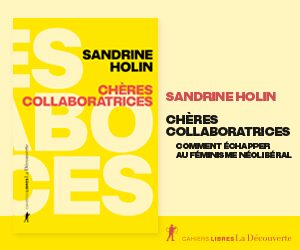
Cette critique « nationale-républicaine » rejette complètement l’idée d’un racisme comme rapport social et considère qu’il résulte uniquement d’attitudes individuelles, autrement dit d’une opinion, éventuellement traduite en actes hostiles, qu’une idéologie vient justifier. C’est dans le cadre de cette opposition théorique que va se développer une véritable guerre des idées, aux conséquences politiques fortes.
Reconnaître les identités raciales
Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à la situation présente, je pense nécessaire de rappeler que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et notamment après les réflexions élaborées à l’UNESCO débouchant sur les deux premières déclarations sur la question raciale, en 1950 et 1951, l’antiracisme était uniquement considéré dans sa dimension morale : le racisme, c’est le mal. On pensait pouvoir éradiquer le racisme avec des arguments plus ou moins scientistes, selon lesquels la race n’a pas de pertinence biologique. Donc, si la race n’existe pas, le racisme, qui est une doctrine de l’inégalité naturelle des races humaines, n’a aucune raison d’être.
Pourtant, malgré ces déclarations (il y en eut deux autres, en 1964 et 1967), malgré les travaux de plusieurs généticiens des populations comme Jacques Ruffié, la race est remobilisée par les militants antiracistes à partir des années 2000, dans une perspective politique, avec la « théorie critique de la race » : selon celle-ci, la race est un fait social et non biologique, qui a des effets en termes de discriminations sur les personnes racisées, d’une façon générale les non-Blancs. Ces analyses nouvelles et d’une grande richesse ont été vivement critiquées par les intellectuels conservateurs améric
