Ukraine, Russie : les sciences sociales à l’épreuve de la guerre
Que devient le travail du politiste ou du sociologue lorsque son terrain se trouve plongé dans un conflit armé ? La guerre d’Ukraine, à l’instar d’autres guerres passées et à venir, met en péril les enquêtes en cours dans les sociétés russe et ukrainienne, tout en ouvrant de nouveaux questionnements.
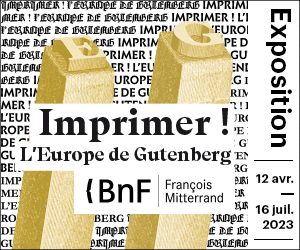
L’impact le plus violent concerne de toute évidence les chercheurs originaires des pays en guerre. Pour les collègues ukrainiens, ce pays n’est pas seulement un terrain de recherche, mais aussi un lieu de vie et de travail. L’exil d’un grand nombre d’entre eux, à l’intérieur et en dehors du pays, de même que la grande précarité, voire l’insécurité physique permanente auxquelles ils se trouvent souvent confrontés, entravent leur vie professionnelle. Souvent bien établis dans leurs pays respectifs avant la guerre, beaucoup se retrouvent à faire vivre des familles entières en exil avec, souvent pour seule ressource financière provisoire, les programmes d’accueil mis en place dans différents pays de l’Union européenne.
Si la plupart des collègues réussissent à maintenir une activité d’enseignement, ils ne peuvent souvent hélas que maintenir une co-présence avec les étudiants. Quant aux recherches scientifiques, elles s’exercent dans des conditions très éloignées des exigences minimales permettant d’assurer la sérénité du travail intellectuel. Les chercheurs en formation éprouvent quant à eux de grandes difficultés à se projeter dans l’avenir, qu’ils soient près ou loin de chez eux. Ces problèmes touchent également les chercheurs russes opposés à l’agression armée qui ont quitté le pays dans des proportions inédites.
Si la guerre pèse incontestablement sur la recherche produite en Ukraine et en Russie, elle affecte également les conditions de production du savoir dans nos pays. Les chercheurs, notamment les spécialistes de la zone, sont confrontés à des problèmes d’accès au terrain, à la nécessité de répondre à une demande sociale aussi intense qu’inhabituelle, mai
