Le féminisme indien face aux violences sexuelles
Parmi les nombreux clichés qui circulent sur l’Inde, celui d’un pays dangereux pour les femmes occupe une place centrale. Le récent classement de l’Inde comme pays « le plus dangereux du monde pour les femmes » par la Fondation Thomson Reuters a ainsi été largement relayé en Inde et en dehors, sur des portails féministes comme dans les journaux généralistes. New Delhi en particulier est souvent désignée comme la « capitale du viol ». La centralité de la question des violences sexuelles au sein des discussions et mouvements féministes n’est ni surprenante, ni nouvelle ; comme dans bien d’autres pays, le viol est devenu un enjeu structurant du féminisme indien dans les années 1970 et 1980 [1]. Toutefois, cette discussion s’est élargie bien au-delà des cercles féministes, comme l’atteste le mouvement populaire en réaction au viol et au meurtre d’une étudiante de Delhi en décembre 2012 (l’affaire Nirbhaya), qui a très largement dépassé les mouvements de femme et le féminisme.
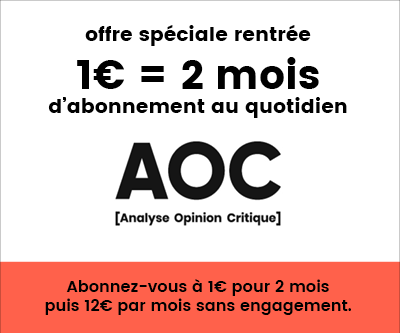
On peut bien sûr se réjouir de l’appropriation de cet enjeu par des acteurs non féministes. Toutefois, l’ouverture de la discussion autour de la violence contre les femmes indiennes au-delà des cercles féministes, et même au-delà de l’Inde, s’accompagne de formes de rétrécissements, que ce soit dans la façon dont les enjeux sont problématisés, ou dans les solutions qui sont proposées. Les débats actuels sur la violence sexuelle en Inde, que ce soit au niveau national ou global tendent à ainsi à être réducteurs, alors même que les réflexions et débats féministes ont pensé cette question de façon riche.
Il faut donc, dans un premier temp, porter un regard critique sur la façon dont la question de la violence contre les femmes indiennes est discutée, à la fois localement en Inde, et globalement. Il ne s’agit pas ici de nier la réalité de ces violences, mais de mettre en évidence leur mise en récit, et les implications de cette dernière. Cette analyse critique doit d’ailleurs être mise en perspective
