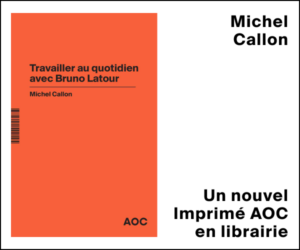Peut-on encore « aller mal » sans pour autant « être malade » ?
On ne compte plus les constats alarmants sur la misère de la psychiatrie française[1] auxquels depuis quelque temps viennent s’ajouter les alertes sur la santé mentale des Français.
La dénonciation de la paupérisation de la psychiatrie ne peut pourtant se poser qu’en termes de moyens, elle doit s’accompagner d’une réflexion sur la manière dont nous soignons la souffrance psychique, qui est elle-même dépendante du statut que nous accordons au psychisme et à la vie psychique. Il ne s’agit pas d’un problème qui concernerait les seuls praticiens ou les épistémologues de la psychiatrie mais la société toute entière, école comprise.
Or force est de constater que nous n’avons pas, ou trop peu, cette discussion. C’est bien un certain paradigme, que l’on pourrait appeler par commodité le paradigme « biomédical » qui est devenu hégémonique. Au sein de ce paradigme, toute souffrance psychique doit recevoir une caractérisation nosographique – il faut l’inscrire dans une classification pathologique désormais extensive[2]. Il faut donc d’emblée l’associer à un comportement immédiatement repéré comme « anormal ». Mais cette anormalité est entendue en un sens tout à fait spécifique : elle renvoie à une inadaptation aux normes et aux injonctions sociales, et jamais ou trop peu, à ce que le sujet peut ou ne peut plus supporter pour lui-même, « ce sentiment de vie contrariée » dont parlait Canguilhem lorsqu’il définissait la maladie comme sentiment d’une puissance vitale amputée.
Tout diagnostic inscrit donc a priori le sujet dans le spectre d’un trouble pathologique, c’est là le nerf du « diagnostic », passage obligé de la « prise en charge » du patient : du trouble psychique à la maladie mentale, il y a désormais continuum. Nous sommes entrés dans l’ère où la qualité d’une vie psychique heurtée ne semble pouvoir être appréhendée qu’à l’aune de catégories pathologiques, dans une langue protocolisée, désincarnée, abstraite de tout ce qui pourrait la rendre singulièrement signifiante.