Des magistrats en souffrance
Le décès en octobre 2022 d’une magistrate en pleine audience à Nanterre a suscité une forte émotion dans le monde judiciaire. Cet événement dramatique s’inscrit dans une tendance longue de plusieurs années, qui a connu son paroxysme dans la publication d’une tribune en novembre 2021 dans Le Monde, à la suite du suicide d’une magistrate.
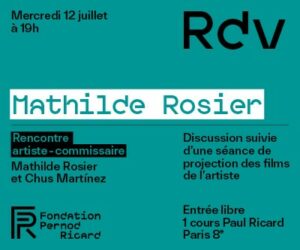
Il s’inscrit dans une réflexion générale sur les conditions de travail dans le monde judiciaire, réputées particulièrement difficiles et pouvant conduire, notamment dans la magistrature, à des risques psycho-sociaux. Si ces difficultés sont devenues un problème public, c’est aussi parce qu’elles sont causées par un sur-travail lié à un manque de personnel mais aussi à des inquiétudes quant au sens de leur mission, qui est de rendre la justice. Pour autant, au-delà de ce principe général, les difficultés varient fortement selon les lieux d’exercice, les fonctions et le moment de la carrière des magistrat·es[1].
Un constat partagé et des alertes répétées
Depuis les années 2010, les organisations syndicales de magistrat·es alertent le ministère de la Justice et l’opinion publique sur leurs conditions de travail. Dès février 2015, l’Union syndicale des magistrats (USM) publie un livre blanc intitulé Souffrance au travail des magistrats. État des lieux, état d’alerte. Il fait suite à un autre livre blanc publié en 2010, consacré à « l’état de la Justice », qui dressait un bilan très négatif de la situation du monde judiciaire. La difficulté des conditions de travail constitue en 2018, le cœur d’une enquête menée par le Syndicat de la magistrature (SM), dont les résultats paraissent en 2019 dans une brochure intitulée L’envers du décor. Enquête sur la charge de travail de la magistrature. Les résultats de l’enquête montrent que « loin de relever de la situation individuelle exceptionnelle, la souffrance au travail est une réalité silencieuse mais fréquente, produit structurel d’une organisation qui ne vise qu’à faire toujours plu
