Au-delà des murs blancs – sur « Art is Magic » de Jeremy Deller
Il fallait bien l’échelle d’une ville (Rennes) et trois sites qui sont autant de types d’institutions artistiques (le Frac Bretagne, le Musée des beaux-arts de Rennes et La Criée, centre d’art contemporain) pour accueillir sous la forme d’une rétrospective (ou presque) la pratique généreuse et protéiforme développée par l’artiste britannique Jeremy Deller ces trente dernières années. Le public français n’avait pas bénéficié d’une présentation d’envergure de son travail depuis D’une révolution à l’autre, sa carte blanche au Palais de Tokyo en 2008, une proposition qui, à n’en pas douter, a marqué toute une génération de curateur·rice·s, d’artistes et d’amateur·rice·s d’art.
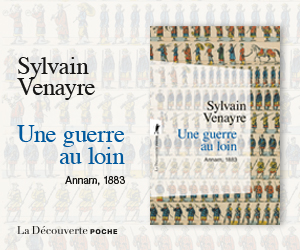
Lauréat en 2004 du célèbre Turner Prize, représentant de la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise en 2013, Jeremy Deller est – disons-le sans ambages – un artiste majeur de la scène artistique contemporaine, auteur de quelques œuvres iconiques qui témoignent, par les méthodes d’investigation, les modes d’apparition et les sujets proposés, d’une volonté de repousser les frontières convenues de l’art tout en réaffirmant sans cesse sa croyance en son pouvoir magique, sa capacité de transformation, à être aussi spirituel et politique qu’absurde et stupide. « Art is Magic » nous prévient-on avec ce titre, qui sonne comme la profession de foi de celui qui a plus d’un tour dans son sac.
Jeremy Deller réalise ses premières œuvres au milieu des années 1990, après l’explosion sur la scène internationale des Young bristish artists, une constellation d’artistes issu·e·s pour la plupart du Goldsmiths college of art à Londres, comme Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas ou Dinos et Jake Chapman, qui allait défrayer la chronique et battre des records sur le marché avec le soutien de l’homme d’affaire, collectionneur et galeriste Charles Saatchi. Deller ne partage pas grand-chose avec eux, ni leur stratégie économique agressive, ni leur goût pour le scandaleux, le monumental et le démonstratif. Il n’
