Urbex, qu’est-ce que c’est ?
Faut-il définir une pratique qui se veut une conquête de libertés, porteuse de transgressions ? C’est en effet un des paradoxes de l’exploration urbaine (« urban exploration »), souvent abrégée urbex que de se situer en dehors de considérations légales et pourtant de susciter de nombreux débats sur les cadres formels qui doivent la régir. Hors la loi, mais non sans normes.
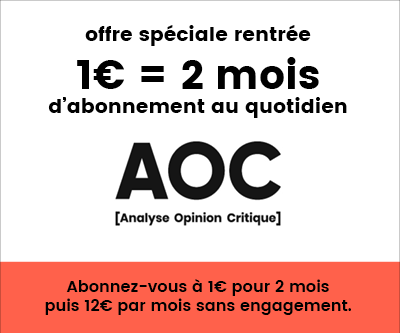
A vrai dire beaucoup ont fait de l’urbex sans le savoir, sans utiliser le terme ou sans même qu’il soit encore formalisé et diffusé, à la fin des années 1990 et dans les années 2000. L’exploration urbaine désigne en effet une errance, une visite sur des sites interdits, abandonnés ou marginalisés, de manière illégale ou du moins non-autorisée. Sous ce large manteau s’abritent en vérité des intentions et des méthodes fort variées. Toute définition trop stricte risquerait d’être peu opératoire. Il y a les aventuriers qui aiment le frisson de l’interdit ou du danger, qui réside autant dans la vétusté des installations que dans le risque de se faire attraper par les propriétaires, les gardes ou les forces de l’ordre. Il y a surtout les passionnés de l’esthétique photographique des ruines. La photo urbex est devenue un genre canonique qui suscite partout dans le monde des expositions et des albums, avec des sous-genre même, comme les photos de nus dans les ruines dont chacun pourra juger du bon goût, ou pas.
Une autre forme de pratique de l’urbex veut en faire une sorte de laboratoire politique pour lutter contre le contrôle urbain, pour desserrer les contraintes spatiales du monde capitaliste occidental. De véritables équipes pénètrent alors, dans cet esprit, différentes installations sans intentions autres que de s’y promener, même lorsqu’elles ne sont pas abandonnées, comme des lignes de métro ou des immeubles en construction. Les motifs pour urbexer sont ainsi nombreux et s’entremêlent souvent.
Pour que les lieux gardent leur aspect sauvage « urbexable », il faut qu’il n’y ait pas trop de visites
