Repenser les retraites en s’inspirant de penseurs socialistes canadiens
Cela a été abondamment dit : lors du débat sur les retraites qui a occupé la France une bonne partie de l’année, le parti au pouvoir, à commencer par Emmanuel Macron lui-même, ont délibérément limité ses termes en choisissant comme unique levier de réforme l’âge de la retraite et la durée des cotisations – au lieu d’agir, par exemple, sur un ensemble de critères comme le montant de ces cotisations, leur répartition entre patronat et salariat, et l’apport de l’État.
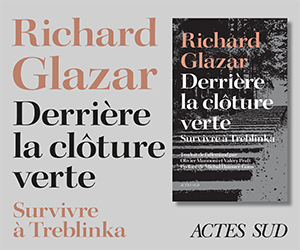
De nombreux chercheurs, en économie notamment, ont contribué à ouvrir l’espace des possibles intellectuels – sinon gouvernementaux – afin de lutter contre cette antienne néolibérale : TINA (There is no alternative)[1].
En tant qu’historiens de la protection sociale au Canada et en Europe dans les années 1930, nous pensons que notre discipline et les exemples tirés du passé peuvent aider à ouvrir encore davantage cet espace des possibles, pour penser d’autres solutions, qui paraîtront certes ambitieuses, mais qui n’en ont pas moins fait l’objet de réflexions tout à fait sérieuses et savantes en leur temps. Lors de la Grande Dépression, au Canada comme ailleurs, le chômage de masse a suscité un débat politique crucial : comment protéger les travailleurs des risques que leur faisait courir l’économie capitaliste ? Ces risques étaient devenus indéniables. Chaque travailleur et sa famille pouvaient basculer dans la pauvreté du jour au lendemain, sans espoir d’en sortir.
Le cas du Canada est particulièrement intéressant pour retracer les origines des luttes politiques entourant la mise en place de l’État social, et donc pour comprendre la logique profonde sous-tendant les retraites. Aucun pays n’a été épargné par les effets de la crise économique des années 1930, et ces luttes ont eu lieu dans le monde entier, bien que les programmes qui en ont résulté aient été très différents d’une région à l’autre. Contrairement à plusieurs pays européens dont la France, le Canada n’avait alors aucune assurance soc
