Mémoires du Chêne Pointu : chronique d’une destruction annoncée
« (…) créer un édifice est chose naturelle, mais le ressusciter, cela tient du miracle.[1] »
Quatremère de Quincy
Dès le milieu des années 1950, les villages boisés et très peu peuplés des communes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois, lieux de villégiature des parisiens depuis la fin du 19eme siècle, sont précipitamment métamorphosées par la construction accélérée des grands ensembles.
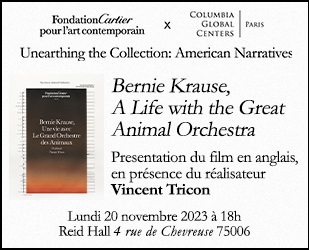
Plusieurs vagues d’urbanisation recouvrent ce tissu pavillonnaire et vallonné de barres et de tours en béton armé. La construction de plusieurs grandes copropriétés dont celle du Chêne Pointu font partie d’un projet urbain conçu en 1960 par Bernard Zehrfuss et Fernand Ottin pour la construction de 10 400 logements privés. À sa livraison, la cité du Chêne Pointu avec ses rez-de-chaussée lumineux et traversants entourés d’une végétation dense « fait la joie des classes moyennes[2] » parisiennes, enfin propriétaires. Mais les vices cachés de cette « cité radieuse » ne tardent pas à se révéler. Ils sont à la fois endémiques, parsemés entre les lignes du projet lui-même, mais également issus d’une gouvernance défaillante à plus grande échelle.
L’emplacement, à seulement 15 km de la capitale et de ses emplois, ajouté à la promesse d’une future autoroute A87 qui connectera le quartier à Roissy, Marne-la-Vallée et Paris, représentent le socle d’un tel projet. Son développement va néanmoins à l’encontre des avertissements du Plan d’Aménagement de la Région Parisienne (PARP) de 1939 qui signale que l’implantation de l’activité industrielle et d’un réseau de transport sur ce secteur seront entravés par le relief escarpés des trois plateaux qui le constituent[3]. En 1982, l’infrastructure tant attendue est finalement abandonnée par l’État et le quartier se retrouve enclavé pour plusieurs décennies, à 1h30 de trajet en transport en commun de Paris et son bassin d’emploi.
Il faut attendre les émeutes de 2005 à la suite de la mort des jeunes Zyed et Bouna dont le Chêne Pointu est l’épicentr
