La vie des cages – sur l’exposition « Animal politique » de Gilles Aillaud
Pour Aristote, l’auteur de cette fameuse formule, l’être humain est bien un tel « animal politique », c’est-à-dire un animal social, « doué de logos ». D’entrée de jeu, ce titre est problématique, mais il a le mérite de nous faire entrer à pieds joints dans la complexité de la démarche picturale.
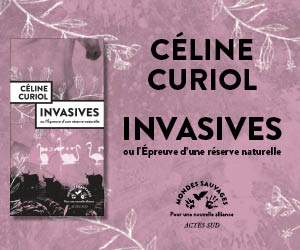
C’est sans doute les propos de Jean-Christophe Bailly, au sujet du logos de l’animal, qui sont les plus éclairants : « l’animal n’est pas l’homme encore en enfance, il est ailleurs, il est lui-même, il est comme un pays et là, dans ce pays qu’il est, sans logos il dispose du logos, ce qui ne revient pas à dire qu’il parle ou qu’il pense à la façon des hommes, mais qu’il est lui-même lancé comme une pensée qui va[1] ». Visiter cette exposition, c’est arpenter ce pays si particulier. C’est tenter de saisir l’ambitieuse réflexion philosophique d’un peintre qui a fait du caractère pensant et pensif de l’animal le motif incarné de sa peinture.
Le travail de Gilles Aillaud est aussi trompeur que les apparences elles-mêmes. Lorsqu’en 1978, ce dernier est interrogé sur le sens de son œuvre sur France Culture, à la question de savoir s’il y aurait une symbolique à peindre des animaux enfermés dans des cages, il répond : ce que vous voyez est ce que vous voyez, de la peinture, rien de plus. Rien n’est symbolique ou métaphorique. Vous voyez un singe dans une cage. Et non une image de l’homme. Vous voyez un singe dans une cage. Certes, l’homme a mis le singe dans la cage. Certes, il l’a mis là pour pouvoir le regarder. Mais il n’y a pas de message. Car il s’agit de peinture, de matière et de présence, avant tout. Et si la peinture répond aux enjeux du pouvoir à sa manière, c’est avec les moyens techniques qui lui sont propres et ses outils silencieux qu’elle le fait.
Certes l’époque où ces œuvres sont réalisées est bien celle des travaux de Michel Foucault (on citera bien entendu Surveiller et punir, 1975) ; et c’est aussi l’époque des actions du GIP visant à rendre publiques
