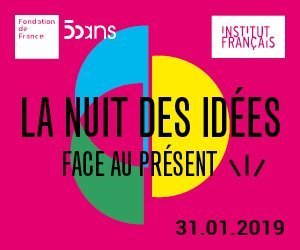Comment « l’universalisme républicain » sape la politique contre les discriminations
Le 21 octobre 2018, on ne commémorera ni le discours prononcé vingt ans plus tôt par Martine Aubry, alors ministre de l’Emploi et de la Solidarité du gouvernement Jospin, ni le lancement de la politique contre les discriminations raciales [1] qu’il a rendu possible. En revenant sur les modalités choisies pour formuler cette question en France et les étapes diverses de mise en œuvre d’une action anti-discriminatoire, on voudrait montrer ici comment ce qui s’annonçait comme un vaste mouvement de reconnaissance a en fait pris la forme d’un non-lieu [2].
Jusqu’à la fin des années 1990, la notion de discrimination raciale avait été en effet peu présente dans le dispositif politique et juridique français. La loi Pleven de 1972 avait marqué l’entrée dans le Code pénal français d’une condamnation de ce type de traitement. Mais elle le concevait comme une des manifestations possibles du racisme, sans qu’une distinction soit établie entre le type spécifique d’inégalité qu’il produit et les comportements racistes comme l’exclusion, l’insulte ou le crime, prioritairement visés par la loi. Très fortement marquée par le texte défendu depuis 1959 par la commission juridique du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), cette loi ne prévoyait pas, du reste, la création d’organes ad hoc chargés de mener à bien une action anti-discriminatoire.
Cette faible référence aux discriminations raciales dans la loi Pleven s’est traduite par un contentieux limité. Par exemple, sur trois cent quatre-vingts condamnations prononcées entre 1993 et 1997 pour actes racistes, trois seulement concernaient des cas de discriminations à l’emploi [3]. La subordination de cette question à celle de l’antiracisme a également pour conséquence de maintenir la confusion, une fois le phénomène des discriminations raciales rendu visible, voire de faire apparaître aux yeux de certains acteurs associatifs l’anti-discrimination comme une cause concurrente de l’antiracisme.
Des