Israël, année zéro
En cette période de violence extrême au Proche-Orient et dans les esprits, partout, dans les mots devenus des armes, nous, Israéliens, Juifs, cherchons d’autres voix dans le passé, dans le judaïsme, dans le sionisme. Une voix éminente est celle de Martin Buber, grand penseur juif allemand de dialogue, qui publiait, il y a exactement un siècle, Je et Tu.
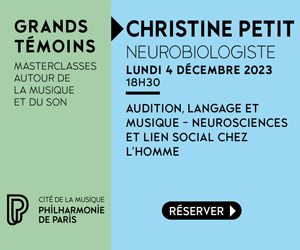
Buber n’était pas seulement un pilier de la pensée juive au 20e siècle, mais aussi une figure centrale du mouvement sioniste. Face à ceux qui qualifient son sionisme de spirituel et moral, pour l’opposer au sionisme politique de Herzl et de Ben Gourion, Buber, lui, mettait en cause la séparation du politique et de la morale comme un mal ayant frappé la civilisation européenne moderne.
L’un des discours mémorables de Buber sur le sionisme a été prononcé le 31 octobre 1929, deux mois après une série de massacres atroces perpétrés par des Arabes, à l’époque la majorité dominante en Palestine, contre la minuscule minorité juive des villes comme Jérusalem, Hébron et Safed. Ces événements ont donné lieu à l’assassinat brutal et à la torture de 133 hommes, femmes et enfants juifs et à l’extinction définitive de communautés juives entières, comme celle de Gaza. L’historien Hillel Cohen a qualifié l’année 1929 d’ « année zéro du conflit arabo-israélien ». Entre cette tragédie initiale et les massacres du 7 octobre les parallèles effrayants sont effrayants.
Ce jour d’octobre 1929, Martin Buber prononçait un discours devant la section berlinoise de l’association « Brit Shalom », dont le nom, « alliance de paix » en hébreu, résume la vision bubérienne du sionisme. Pour lui, le sionisme n’était pas seulement un autre avatar du nationalisme visant à promouvoir les intérêts propres d’un peuple particulier, ce que Buber critiquait comme « égoïsme collectif ». Buber voyait le sionisme plutôt comme un projet national juif dans un sens fondamentalement différent, c’est-à-dire un projet visant à établir une politique enracinée
