Anamnèse et transmission – sur La Maison Gainsbourg
« Quelle musique peut guérir
le cœur captif, le mal de ce fantôme
las de toujours renaître, pour périr ? »
Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, 1942-1943
Le patrimoine est à la fois un héritage et une hantise. Les monuments, les bâtiments, les murs procèdent d’une « hantologie », comme aurait dit Jacques Derrida, le philosophe de l’archive et de la trace. Une hantologie qui croise le plus intime de l’individu et le plus dialectique du groupe, tout en s’alignant sur le modèle anthologique de la distinction, de l’inventaire ou de la collection.
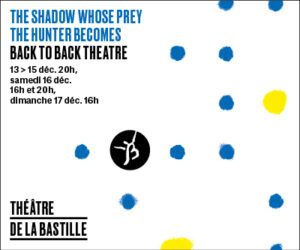
La passion actuelle pour les sites « remarquables », les villes « d’art et d’histoire » ou, plus visiblement encore, les maisons des « illustres » confine parfois à une opération d’industrialisation culturelle sous la forme d’une mise en label et d’une mise en série sans âme. Toutefois, il arrive qu’un lieu échappe à cette fatalité standardisée et fasse entendre une autre voix, une autre destinée, une autre spectralité. Tel est le sentiment qui se manifeste tout au long de la visite que l’on peut faire de la Maison Gainsbourg. Tout particulièrement en ce moment, dans la période tourmentée que nous traversons.
La maison comme texte
Rompant avec les topoï du « génie du lieu » et du « lieu du génie », la « Maison historique de Serge Gainsbourg » se présente avant tout comme un texte. A lire, à parcourir, à ressentir, à méditer… Or, un texte est soumis aux moments, aux époques et donc aux contextes qui fluctuent constamment, en réalité. Face au très grand succès rencontré par l’ouverture de ce nouveau lieu parisien, il convient de s’inscrire bien à l’avance pour obtenir un rendez-vous afin de pouvoir le découvrir.
Dans mon cas, lorsque j’ai fait la réservation cet été, je n’aurais pas pu imaginer quelles résonances, ou plutôt quelles revenances, viendraient accompagner la visite que j’en ferais quelques mois après, en ce mois de novembre. En l’espèce, la rencontre avec cette maison a totalement déjoué l’horizon de mes a
