Bertrand Bonello : « Le plus difficile, c’est d’inventer un futur relativement proche »
En 2044, l’intelligence artificielle a pris le contrôle de la société pour éviter la disparition de l’humanité. Gabrielle, interprétée par Léa Seydoux, replonge dans ses vies antérieures pour décider si elle efface ses affects de sa mémoire, seul moyen d’accéder à des emplois intellectuels et à responsabilité dans un monde régi par les entretiens d’embauche. Elle replonge dans son existence en 1910 et en 2014 et dans la relation qui a failli l’unir à Louis qu’elle a aimé à travers les siècles.
Acclamé par la presse internationale lors de la Mostra de Venise, le onzième long-métrage de fiction de Bertrand Bonello reprend l’argument de La Bête dans la jungle, court roman de Henry James publié en 1903, pour en faire un bouleversant mélodrame atemporel autant qu’un récit dystopique d’un pessimisme glaçant, cheminant à travers les peurs du siècle.
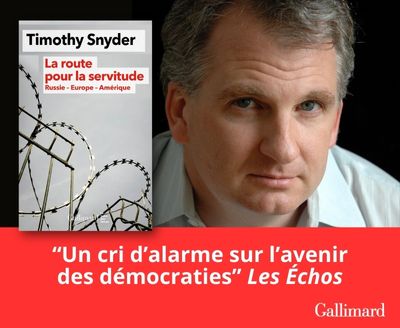
Le réalisateur qui, dans une autre vie, fut un tout jeune pianiste avant de devenir musicien de studio, a mis en scène les 9, 10 et 11 janvier derniers à la Philharmonie de Paris Transfiguré – 12 vies d’Arnold Schönberg. À travers un choix de douze pièces, clin d’œil au système dodécaphonique qu’il a inventé, le spectacle qui allie images et textes est un portrait diffracté du musicien viennois. Sous la direction de la cheffe d’orchestre Ariane Matiakh, Transfiguré, qui sera diffusé sur Arte à l’automne, parcourt trente ans de l’œuvre du compositeur dans l’histoire tourmentée de l’Europe de la première moitié du XXe siècle qu’il a fuie pour Los Angeles. RP
Dans La Bête, quand le personnage de Louis s’intéresse à la partition que Gabrielle travaille au piano, elle lui répond au sujet d’Arnold Schönberg : « Je souffre, c’est plein d’invention mais j’ai du mal à trouver le sentiment à l’intérieur de ça ». Est-ce que ce dialogue reflète votre propre difficulté à vous emparer de ce compositeur jugé difficile pour créer Transfiguré – 12 vies d’Arnold Schönberg, un spectacle hybride donné récemment à la Philharmonie ?
La raison pour laquelle j’ai choisi que Gabrielle interprète du Schönberg dans la première époque du film située en 1910, c’est qu’il s’agit d’une pièce qui date de 1909, c’est-à-dire au moment où le compositeur commence à entrer dans l’atonalité. Il s’agissait de montrer qu’en dépit de son milieu bourgeois, Gabrielle est une femme très moderne. Cela permettait aussi de mettre dans sa bouche, comme dans toutes les conversations elle parle d’art avec Louis, un discours indirect sur le sentiment amoureux. Schönberg est pour moi, du début à la fin de son œuvre, un grand romantique. Pas uniquement dans Pelléas et Mélisande et La Nuit transfigurée, pas seulement dans son côté post-Mahler. Je ne pense pas qu’à son romantisme poussé à l’extrême fasse suite une rupture cérébrale qui amènerait à des compositions froides et intellectuelles. Gabrielle ne perçoit pas encore le sentiment dans la partition parce qu’il est difficile à trouver, il n’est pas affiché, il faut aller le chercher.
Ces deux projets dont la préparation a été concomitante se sont-ils nourris l’un l’autre ?
J’ai commencé le scénario de La Bête en 2017, puis j’ai cessé d’y travailler pour réaliser Zombi Child en 2019 et Coma en 2022. Il est ensuite devenu une mini-série sous le titre Les Possédés, puis il s’est scindé en deux longs métrages. Je n’ai pas financé le premier. La Bête est le second et il a mis du temps à trouver sa forme. Son scénario était terminé avant qu’on me propose une carte blanche à la Philharmonie mais il est vrai que pendant six mois, j’ai travaillé sur La Bête la journée et sur Schönberg le soir. C’était un exercice non pas schizophrène parce que des liens existent, mais intense. Finalement, des choses se répondent.
Ce spectacle effectue une sélection d’œuvres de Schönberg auxquelles vous avez mêlé la projection d’images et des textes ainsi que la participation de deux comédiens, Julia Faure et Adrien Dantou. On est frappé d’y retrouver de nombreux motifs de votre cinéma et des résonances avec La Bête, notamment la structure du voyage temporel. Transfiguré parcourt une vingtaine d’années dans la vie et l’œuvre du compositeur.
La demande de la Philharmonie était celle d’une certaine pédagogie dans le meilleur sens du terme. Il s’agit d’un compositeur difficile à appréhender pour beaucoup de spectateurs. Le meilleur moyen d’être pédagogique, c’était de passer par la chronologie, à l’exception d’un unique moment où l’on triche dans la succession des œuvres. Attaquer par le concerto pour piano aurait pu perdre les non-connaisseurs de cette musique. Si on part du début pour aller jusqu’à la fin, on comprend l’évolution. La conception du spectacle a consisté à mélanger en un seul trajet des dramaturgies intimes, musicales et historiques. La difficulté était de concevoir un spectacle qui, contrairement à un opéra, ne pouvait pas s’appuyer sur un livret. Le plus gros du travail a été à l’intérieur de chaque pièce, quelle image allait pouvoir naître, étudier les variations, sa vie, les résonances… On retrouve des choses de La Bête c’est certain !
La Bête navigue à partir d’un présent dystopique qui met en scène une version post-apocalyptique de notre monde où l’intelligence artificielle a pris le contrôle. Aviez-vous dès 2017 le sentiment d’adopter une place de vigie face aux peurs de l’avenir ?
Cela ne se manifeste évidemment pas comme un désir conscient. Mes émotions d’artiste font que j’essaie de traduire les peurs que je perçois avec des personnages, des situations, des dialogues… des choses cinématographiques ! La peur n’est pas ouvertement scénarisée ou nommée dans La Bête, elle se manifeste comme un bruit sourd. Il existe deux sortes de peur : une peur totalement salutaire qui fait qu’on est aux aguets et qui nous rend perméables au monde, et une autre, bien plus atroce, qui paralyse. Je l’ai mise en scène jusqu’à l’extrême en poussant le scénario jusqu’au genre du slasher.
La prise de pouvoir de l’intelligence artificielle est arrivée assez tardivement dans le scénario et initialement, elle n’apparaissait qu’à la fin du film. Quand j’ai pensé à en faire le présent du film cela m’a permis de créer des concepts qui naviguent dans l’histoire de façon très libre. Dès ce moment, j’ai fait beaucoup de recherches à partir d’un numéro spécial de Libération extrêmement bien fait qui m’a donné beaucoup de clés ainsi qu’en travaillant avec un chercheur, Alexandre Pachulski, auteur d’un livre sur la représentation de l’intelligence artificielle au cinéma. Quand je me suis documenté à partir de 2018, j’imaginais que les craintes relayées dans les articles se situaient à un horizon de quinze ou vingt ans. Je ne me rendais pas compte que cette question serait si actuelle l’année où le film serait montré. Quand le film a été projeté à la Mostra de Venise en septembre dernier, c’était le sujet brûlant. Au-delà de la grève des acteurs et des scénaristes, tous les journaux ont fait leur une sur ce sujet au printemps. Ce qui rend, presque malgré moi, le film très contemporain.
En 1910, en 2014 et en 2044, Gabrielle et Louis éprouvent une même peur que leur amour soit empêché. Cela pourrait être la définition même du mélodrame.
Je n’avais jamais pensé adapter Henry James, mais l’idée du mélodrame m’a poussé vers La Bête dans la jungle. L’amour et la peur qui sont au cœur de ce court roman magistral y cohabitent très bien et je les ai poussés à fond dans mon scénario. Je fais ce que l’on peut appeler une adaptation libre, majoritairement placée dans la longue scène de bal du début de douze minutes. J’y reprends les sublimes dialogues de James qui est un génie dans l’observation de l’âme humaine. Le film n’est pas uniquement un mélodrame. Il navigue entre les genres, dans le slasher et la science-fiction.
Dans la première séquence, vous vous adressez directement à votre actrice Léa Seydoux sur fond vert, en lui demandant si elle peut avoir peur de quelque chose qui n’existe pas. Ce prologue désigne le film comme un laboratoire de ce qu’est une actrice et, plus précisément, de ce qu’est Léa Seydoux dans le cinéma français aujourd’hui.
Le fond vert est associé par n’importe quel spectateur à l’idée de virtualité qui allait bien avec ce dont parle le film. La première séquence, de manière très cash, dit à l’actrice : « Le sujet, c’est toi ».
Qu’est-ce que Léa Seydoux a d’extraordinaire pour un cinéaste ?
On ne sait pas ce qu’elle pense. Elle n’est pas froide, elle joue de manière émotionnelle mais on ne sait pas ce qu’il y a derrière son visage. C’est ce qui la rend fascinante et c’était nécessaire au film. Sa cinégénie très particulière, moderne autant qu’atemporelle, lui permet de traverser les époques. Cela faisait longtemps que nous avions envie de nous retrouver autour d’un projet dont elle serait le centre.
Avez-vous senti une évolution dans sa façon de jouer depuis De la guerre en 2008 et Saint Laurent en 2014 dans lesquels elle tenait des rôles secondaires ?
Elle fait preuve aujourd’hui d’un abandon qu’elle n’avait pas auparavant. Léa n’est pas une actrice qui travaille. Je pense que la rationalisation du rôle lui fait peur. Elle découvre la scène en la faisant. Ce n’est pas parce qu’elle arrive non préparée qu’elle a besoin de beaucoup de prises. J’ai l’habitude d’en faire peu. Dès la deuxième, elle comprend. Je crois qu’elle a besoin de se laisser surprendre, de ne pas arriver avec une idée de ce que la chose sera. George MacKay est l’inverse absolu. Pour arriver totalement détendu sur le tournage, il sur-prépare, comme le veut la tradition anglo-saxonne.
Le rôle de Louis était initialement dévolu à Gaspard Ulliel, disparu tragiquement en 2022. Avez-vous choisi George MacKay pour rendre impossible toute comparaison ?
J’ai choisi un anglophone pour qu’on ne puisse pas le comparer avec Gaspard. Dès les essais de George, j’ai été conquis par son niveau de jeu. Il a des façons de jouer extrêmement différentes selon les époques, tandis que Léa traverse les différentes périodes du film toujours un peu de la même manière.
Lorsque Gabrielle imite pour Louis l’expression neutre du visage des poupées de celluloïd fabriquées industriellement par son mari, le mimétisme est troublant. On a le sentiment que le visage des poupées a été modelé sur celui de l’actrice. C’est un objet qui traverse votre cinéma depuis longtemps, notamment dans le court métrage sur la photographe Cindy Sherman Cindy, The Doll Is Mine, dans L’Apollonide ou plus récemment dans Transfiguré où sont projetées des photos d’amas de poupées.
Le plan dont vous parlez est le premier que nous ayons tourné et il s’agit de sa première prise. Une poupée a quelque chose d’enfantin et de terrifiant à la fois dont on ne sait pas ce qu’elle exprime. Gabrielle insiste sur la neutralité de l’expression. C’est un objet très fort visuellement dont s’est emparé le cinéma de genre.
Le sentiment amoureux qui unit Gabrielle et Louis à travers les âges a beau être ce qu’ils possèdent de plus intime, il est également modelé par les différentes époques qui leur donnent des peurs, des gestes, des codes sociaux qui les dépassent.
La peur d’aimer se situe de son côté à elle en 1910 parce que les conventions empêchent une femme mariée de s’abandonner à son sentiment. En 2014, la peur d’aimer se situe de son côté à lui sauf que, incapable de la nommer, il la détourne en la désignant comme une haine des femmes. Louis Lewanski est un produit de son époque, de cette mise en scène de soi par les réseaux sociaux, de cette amnésie, du refoulement, de la solitude.
Comment avez-vous travaillé le rendu des trois époques d’un point de vue sonore et visuel ?
Le 35 mm donne de la sensualité et de l’élégance à la partie située en 1910 alors que le digital convenait très bien aux deux autres parties qui sont plus tranchantes. Pour la partie à Los Angeles, je me suis appuyé sur des choses existantes comme les vidéos d’Elliott Rodger, incel revendiqué et auteur d’une tuerie de masse. Le plus difficile, c’est d’inventer un futur relativement proche. J’ai fait le choix de travailler sur des différences comportementales plutôt que visuelles : les rues, les bâtiments sont les mêmes, mais j’ai fonctionné par soustraction en enlevant les voitures, les écrans, les publicités. Les intérieurs sont éclairés par des boîtes lumineuses de luminothérapie. La médiation d’un appareil n’y est plus nécessaire pour communiquer à distance. Ces petites inventions permettent de donner un sentiment qu’on n’est pas dans la science-fiction de surtechnologie mais que ce sont les relations entre les gens qui ont changé. Pour rendre le son irréel, j’ai post-synchronisé toutes les scènes en extérieur. J’ai effectué un travail par le vide.
La peinture du futur passe également par un nouveau rapport à la distance entre les corps et aux gestes. Louis pratique le yoga que l’on connaît, mais la répétition des séquences de gestes lui donne quelque chose de mécanisé, robotique. Lorsque Gabrielle danse seule chez elle, vous lui inventez des mouvements inédits.
Je me suis inspirée d’une danse israélienne, le gaga, que j’ai poussée un peu plus loin pour en éliminer la symétrie, pour la rendre relâchée mais d’une manière neuve.
Les costumes du futur sont eux aussi très dépouillés, pas du tout extravagants comme c’est souvent le cas dans les films futuristes.
Nous avons travaillé sur des matières nobles, mais des coupes qui ne mettent rien en valeur car le narcissisme et la séduction ont disparu dans ce monde. Trouver cette neutralité a demandé du temps.
La Bête navigue dans trois époques qui possèdent chacune un pouvoir d’évocation de toute une cinéphilie. On ressort du film en ayant repensé à des films de David Lynch, de Wes Craven, d’Alfred Hitchcock ou à votre propre cinéma.
Le film est un voyage dans les genres : le mélodrame, la science-fiction, le slasher. Ces genres convoquent des cinématographies dont je n’ai pas cherché à avoir les références. J’ai revu uniquement deux films pour préparer La Bête : Le Temps de l’innocence (1993) de Scorsese et Terreur sur la ligne de Fred Walton (1979). Je me suis autorisé le mélange des genres qui n’est pas spécialement bien vu, alors que c’est quelque chose que j’adore. Cela passe sans doute par le cinéma des autres que j’ai ingurgité. On m’a fait la remarque qu’il s’agissait d’un film-somme de mon travail. Il ne faut pas sous-estimer la part inconsciente de la création.
Cette histoire d’amour est au fond d’une grande simplicité, mais vous la racontez dans une forme très complexe de répétitions, de changements d’époques, de rimes visuelles qui font que Gabrielle et Louis sont des personnages uniques en dépit de leurs voyages dans le temps.
J’aime cette phrase de Racine dans la préface à Bérénice : « Il y en a qui pensent que cette simplicité est une marque de peu d’invention. » La structure du film est très fidèle au scénario mais je n’ai jamais écrit autant de versions d’un script. Cette cohabitation des époques était très complexe pour produire une histoire unique et non pas trois distinctes, pour que lorsqu’un événement arrive, il résonne dans une autre partie au point que l’on s’en souvienne… C’est millimétré pour éviter le sentiment d’être face à un catalogue.
À la place du générique, le film se termine par un QR code qui permet au spectateur de découvrir sur son smartphone les crédits ainsi qu’une scène cachée qui révèle à Gabrielle la clé de son dilemme. Est-ce une façon de faire passer la durée du film en dessous de la barre symbolique des 2h30, trop contraignante en termes d’exploitation ?
Contractuellement, les génériques sont devenus stratosphériquement longs, le QR code permet aux spectateurs d’y avoir réellement accès sans qu’il soit coupé ou accéléré dans un style qui correspond bien au film. C’est aussi une façon symbolique d’être en dessous des 2h30, c’est vrai. Quand j’ai commencé à travailler sur le financement avec Les films du Bélier, je n’avais aucune idée de la durée, mais il devient même difficile de financer un film comme celui-ci, même d’une durée de deux heures. Alors qu’on voit bien que pour ramener les gens en salle, il faut proposer une expérience. La Bête a besoin de cette durée. J’ai tenté de raccourcir, mais cela ne fonctionnait pas car on perdait trop la sensation de faire un voyage. Les spectateurs n’ont aucun mal à aller en salles pour Oppenheimer…
Ou pour Anatomie d’une chute de Justine Triet sorti cet été et qui dure 2h31.
Exactement. Mais c’est l’exception. Il s’agit d’un film sur lequel toutes les étoiles sont alignées. Donc c’est très étrange, ce rapport des exploitants ou des spectateurs à la durée. Pourquoi n’accepte-t-on pas des films français ce que l’on consent avec le cinéma étranger ?
Dans Où en êtes-vous, Bertrand Bonello ? film de commande du centre Pompidou à l’occasion de la rétrospective qu’il vous a consacrée en 2014, vous vous adressez à votre fille qui n’a vu aucun de vos films. Elle vous demande pourquoi vous ne faites pas de « films normaux comme ceux de Peter Jackson ». Depuis ce moment, on peut sentir dans vos films un changement d’énonciation autant que d’adresse.
Les spectateurs de mes premiers films étaient plus âgés que moi, alors jeune réalisateur. À partir de L’Apollonide, mon public s’est énormément rajeuni. Et depuis Nocturama, n’en parlons pas. Ce n’est pas un désir de jeunisme de ma part. Mes films travaillent la forme, ils ont un certain côté pop, notamment dans le rapport à la musique, ce qui intéresse les jeunes cinéphiles. Avoir une adolescente devant mes yeux fait que je vois le monde à travers ses yeux. J’ai fait une trilogie sur la jeunesse, Nocturama (2016), Zombi Child (2019) Coma (2022), alors que ma vie est tracée, que mes choix sont faits. Ce ne sont pas des comings of age mettant en scène des histoires d’amour, mais des films qui se demandent comment la génération qui vient va s’inscrire dans le monde qui est en train de se fabriquer.
Transfiguré – 12 Vies de Schönberg, par Bertrand Bonello, à la Philharmonie de Paris du 9 au 11 janvier. Prochainement diffusé sur Arte.
La Bête, un film de Bertrand Bonello, en salle le 7 février.
