Un label controversé : les écrivain.e.s transfuges
De Jules Michelet qui l’a thématisée très tôt à Jean Guéhenno, Paul Nizan, Louis Guilloux puis chez Annie Ernaux, l’exemple de Jean-Jacques Rousseau est sans doute la référence la plus constante des écrivains transfuges de classe.
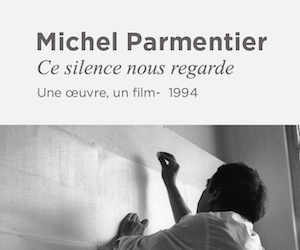
Depuis les années 1970, l’influence des travaux de Bourdieu dans les sciences humaines et au-delà est telle que les récits de transfuges sont désormais pour la plupart entés sur la sociologie critique (Annie Ernaux, Didier Eribon, Edouard Louis, Kaoutar Harchi). Dans ce courant, les récits de transfuges soulignent plus souvent leurs difficultés (malaise, honte, somatisation) que leurs avantages (économiques, sociaux, psychologiques). La focalisation sur l’inadaptation ou le malaise transfuge semble en effet dominer de Jules Vallès à Péguy, de Jean Genet à Violette Leduc, de Louis Calaferte à Annie Ernaux, d’Edouard Louis à Neige Sinno (Triste tigre, 2023). Citons encore, dans cette tonalité, les récits de Tiphaine Samoyault (Bête de cirque, 2013), Kaoutar Harchi (Comme nous existons, 2021) ou Thomas Flahault (Les Nuits d’été, 2022). Tout se passe comme si les conquêtes et la fierté transfuge (diplômes, emplois, argent, relations) demeuraient au second plan, sans doute à cause de leur porte-à-faux vis-à-vis des thèses de la « reproduction » sociale[1].
Pourtant, d’Albert Camus à Marie-Hélène Lafon, de Gérald Bronner à Lori Saint-Martin (« J’ai réussi mon évasion »), de tels récits existent. Avec la notion de « transclasse », Chantal Jaquet (2014) insiste d’ailleurs sur ces possibles : discutant Bourdieu, elle insiste sur les interstices de liberté qui fissurent le déterminisme et sur l’existence de cas exceptionnels malgré la thèse de la reproduction : « Pour pouvoir être lui-même à travers l’autre, le transclasse n’a d’autre alternative que de transformer ce qui l’écrase en levier, de prendre appui sur les tensions en rongeant le frein de la culpabilité pour qu’il devienne moteur[2]. »
Si un transclasse est bien un « immigré de l
