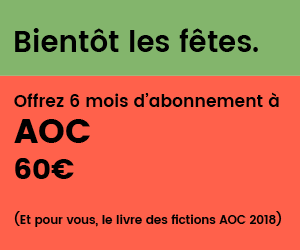Que faire de la défiance ? L’institutionnaliser !
Il n’était pas nécessaire d’attendre les événements les plus récents pour prendre la mesure du sentiment de défiance qui traverse une part très importante du peuple français et qui s’adresse de façon assez globale aux instances de pouvoir, de représentation et de médiation (partis, syndicats, médias…). Mais il paraissait tout aussi évident que la défiance ne suffisait pas à fournir un contenu cohérent, à offrir une perspective politique, car elle est protéiforme : elle prend pour objet différentes institutions et donne lieu à des manifestations d’intensité très variable. Ce caractère diffus est sans doute l’une des raisons pour lesquelles, pendant longtemps, la défiance n’a pas été tout à fait prise au sérieux par les acteurs publics. C’est aujourd’hui ce qui rend si difficile d’y apporter une réponse.
Parce qu’elle n’est pas le simple contraire de la confiance, la défiance ne doit pas être prise comme un bloc. Le Littré nous éclaire sur ce point : « la méfiance fait qu’on ne se fie pas du tout ; la défiance fait qu’on ne se fie qu’avec précaution ». Le sujet défiant est celui qui a besoin de bonnes raisons pour croire ce qu’on l’invite à croire ; et la défiance est un refus de l’autorité, au sens que Hannah Arendt donne à ce terme – une obéissance a priori, pour ainsi dire automatique, se passant de persuasion comme de contrainte.
Ainsi comprise, la défiance est une disposition éminemment démocratique : elle est le propre d’un corps civique qui n’accepte pas de se laisser gouverner sans être convaincu, qui refuse de s’en laisser conter et veut examiner point par point les raisons que lui donnent ceux qui entendent le diriger. Elle traduit bien l’état d’esprit d’une population qui a connu en quelques décennies un élargissement considérable de l’accès aux études secondaires puis supérieures et qui a pris l’habitude de questionner toutes sortes de discours.
La transformation de cette défiance en rejet indifférencié n’est pas inéluctable : la question est de savoir da