Les Gilets Jaunes et la Révolution française : quand le peuple reprend l’histoire
« Sommes-nous en 1789 ? ». En cet automne 2018 et sous différentes formes, la question se réinvite dans le débat public à l’occasion du mouvement des Gilets Jaunes. Elle fait d’ailleurs partie des bons marronniers de la presse nationale et internationale, la France étant encore aujourd’hui regardée, selon les mots du journaliste chinois Hu Xijin, comme « le centre historique de la Révolution en Europe » (Libération, 8 décembre 2018). Les Français seraient-ils une nouvelle fois en train de céder à leurs vieux penchants révolutionnaires ? Pour l’historien américain Steven Kaplan, ils avaient pourtant dit « adieu » à leur révolution lors du Bicentenaire de 1989.
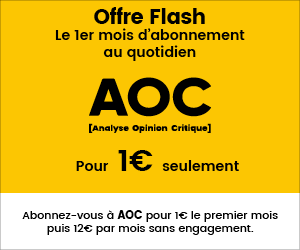
Dans le contexte d’effondrement des régimes communistes, l’Occident avait alors plus généralement abandonné la révolution comme mode possible du changement historique. Le libéralisme était désormais la « fin de l’histoire » (Francis Fukuyama, 1992), ses réformes successives étant présentées comme « nécessaires », c’est-à-dire inévitables, devant une « crise sans fin » (Myriam Revault d’Alonnes, 2012). Un nouveau type de déterminisme émergeait, résumé par le slogan « There is no Alternative ». Englués dans le « présentisme » (François Hartog, 2003), les hommes avaient apparemment décroché avec l’idée qu’ils pouvaient infléchir le cours du temps historique et agir sur le futur.
Ainsi, petit à petit, les sociétés occidentales devenaient plus étrangères que jamais de l’idée même de révolution. Or c’est dans ce contexte précis qu’elle s’est banalisée dans le débat public, transformant le plus petit antagonisme politique, social ou même sportif en « révolution française », inspirant des commentaires essentialistes sur le « tempérament français ». Paradoxalement, cette tendance à voir la Révolution partout a contribué à la dépolitiser, à neutraliser et même à renverser son pouvoir de rupture de l’ordre établi. En marketing ou en politique, la « Révolution » est aujourd’hui un des mots d’ordre du capitalisme et du lib
