Atrophier la parole – sur Bérénice de Romeo Castellucci
«Si nous voulons garder Racine, éloignons-le » écrivait Roland Barthes dans Sur Racine. Il concluait par cette phrase une partie où il prenait en exemple la mise en scène que Jean Vilar proposa de Phèdre au Palais de Chaillot en 1958.
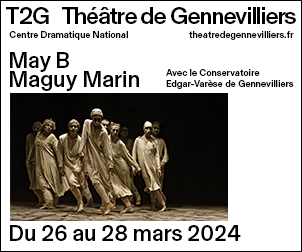
Éloigner Racine voulait dire se défaire du mythe racinien, de tout ce qui dans son théâtre paraît nous ressembler, la passion, les postures, l’allégorie, tout ce qui annonce le théâtre bourgeois, sa psychologie, son drame. Garder Racine, au contraire, c’était restituer le tragique, le caractère divisé, irréconciliable de son œuvre, l’étrangeté de ses personnages, le fait que ce ne sont pas des hommes ou des femmes mais des figures animées par les dieux. Tout ce que, selon Barthes, Jean Vilar ratait.
La mise en scène de Romeo Castellucci est sans aucun doute un éloignement radical. S’il conserve le plissé des étoffes, ces « festons » qu’évoque Bérénice dans l’acte V, il ampute le texte de tous les autres personnages, transformant la pièce en une suite discontinue de monologues séparés par des tableaux scéniques aussi fascinants qu’énigmatiques. Seule, déconnectée du drame, soliloquant dans le vide d’un plateau que traversent des objets qui se refusent à faire sens, Bérénice est aussi lointaine qu’on peut l’être. Est-elle pour autant tragique ? Autrement dit, Castellucci parvient-il à donner corps à l’étrangeté dont parle Barthes, à nous faire sentir ce qu’il nomme, dans la note de programme du spectacle, son « inactualité » ? Je pense qu’il n’y parvient que par intermittence et que, plus fondamentalement, il échoue à faire de Bérénice une figure tragique. Cet échec est passionnant à plus d’un titre, certainement plus passionnant que beaucoup de « réussites » récentes.
Ce qui rate dans ce spectacle, me semble-t-il, est la parole. À trop vouloir l’atrophier Castellucci lui ôte sa puissance propre, qui tient à sa plurivocité, au fait qu’elle est tout à la fois perception, expression, discours et action. C’est en parlant que les p
