Chemsex : sous des désirs chimiques, l’ultramoderne solitude
Le chemsex, apparu il y a une vingtaine d’années, est l’usage sexualisé de nouveaux produits de synthèse. Il convoque un ensemble de tabous : du sexe, homosexuel, avec des drogues, potentiellement en groupe. L’ampleur qu’a pris le chemsex est indissociable des révolutions amenées par le numérique.
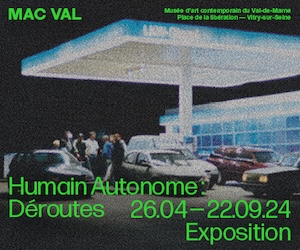
Les applications de rencontres géolocalisées donnent ainsi l’illusion d’une disponibilité permanente et instantanée de nouveaux partenaires sexuels. Des sites de commerce en ligne vendent et livrent ces nouvelles drogues, ouvrant ainsi de nouveaux marchés sans l’intermédiaire de dealeurs.
Le succès du chemsex repose aussi sur un culte de la performance dans la sexualité : toujours plus, plus longtemps. Les substances utilisées ont des propriétés entactogènes, c’est-à-dire qu’elles amplifient la capacité d’empathie et le désir de contact avec autrui. Les usagers décrivent ainsi un sentiment très fort, semblable à de l’amour, déclenché sur commande par des substances, envers littéralement n’importe qui. Cette promesse, qui explique la fascination autour du phénomène, a pourtant un envers, à commencer par la difficulté à avoir une sexualité non augmentée. Avec des conséquences médicales et psychiques qui vont toucher prioritairement les plus vulnérables.
La pratique du chemsex a le plus souvent lieu dans des espaces privés, ce qui la différencie des usages festifs de substances dans des espaces publics ou commerciaux (bars, boîtes de nuit…). Ceci explique l’invisibilisation du phénomène, resté jusqu’à il y a peu sous les radars médiatiques, politiques et sanitaires.
Ouvrir une consultation hospitalo-universitaire spécialisée à destination des usagers problématiques du chemsex en 2017 répondait à un enjeu de santé publique, communautaire, mais aussi scientifique. Car si la pratique du chemsex reste à ce jour majoritairement circonscrite aux hommes homosexuels, ce nouvel usage, hybride biologico-technico-sociétal, a une portée universelle. On peut y voir le symptôme
