L’explorateur et l’exploré – sur la 60e Biennale d’art de Venise
L’homme est aliéné par la division du travail, la lutte des classes, le signifiant-maître, le désir de l’autre, et même le moi, si l’on veut croire Lacan qui voyait en lui le siège de l’aliénation. Il existe toutefois une aliénation bien plus néfaste, celle de la classification des humains en catégories géographiques, culturelles, sexuelles et ethniques, qui se fait depuis toujours au nom de l’art.
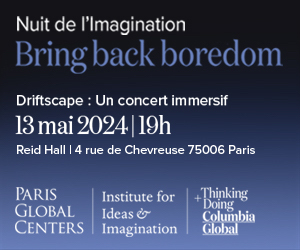
Tout a commencé par les Expositions Universelles, ces lieux de pèlerinage mythiques où l’on présentait les dernières prouesses technologiques des pays occidentaux aux côtés de « villages nègres ». La fétichisation du noble sauvage s’est poursuivie, par la suite, tout au long du modernisme. « Les subalternes peuvent-ils parler ? », se demandait encore Gayatri Chakravorty Spivak en 1988, dans sa critique de l’exclusion hégémonique d’autres voix par le pouvoir blanc.
« Oui, ils le peuvent », semblait vouloir dire Jean Hubert Martin quand, un an plus tard, en pleine fin de la guerre froide, il ouvrait les portes de la mythique exposition « Magiciens de la terre », où il présentait une centaine d’artistes du monde entier, issus de contextes marginaux et pratiquement inexistants dans la conscience du monde de l’art contemporain, aux côtés d’artistes venant des métropoles occidentales.
En 2012, Okwui Enwezor poussa encore plus loin cette poétique ethnographique à travers la Triennale de Paris, « Intense Proximity », pour montrer qu’avec la mondialisation, la distance entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, avait fini par s’effondrer. Les artistes étaient désormais à la fois high-tech et spirituels, modernes et traditionnels, à la fois proches et lointains, mais ce qui primait était tout de même la proximité.
« La proximité est le signe même de la globalisation », disait Okwui Enwezor dans une interview à l’époque, pour en finir une fois pour toutes avec la romantisation ethnocentrique du lointain. Okwui Enwezor est mort en 2019, et nous sommes très nombreux à le reg
