Vers une autonomie politique des quartiers populaires
Le samedi 27 avril 2024, de 9 h 30 à 17 h, s’est tenue la première Assemblée des quartiers (AQ) à la Bourse du travail à Paris.
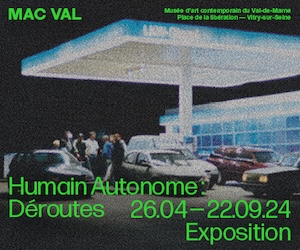
Hébergée dans un lieu emblématique des luttes sociales et syndicales, cette assemblée « Se donne pour objectif de prendre le pouvoir tant au niveau électoral que dans toutes les institutions, qu’elles concernent nos logements (amicales de locataires, collectifs d’habitants et citoyens), notre travail (syndicat), nos écoles (association de parents d’élèves), notre cadre de vie (conseil de quartier, citoyens), nos solidarités (centres sociaux, CAF, services municipaux, etc.) comme tous nos services publics » (Le journal de l’Assemblée des quartiers, 27 avril 2024).
Il s’agit donc d’agir contre l’exclusion politique des quartiers populaires, et d’impulser des luttes contre les formes de dépossession subies par les classes populaires. Pour les initiateur·ices, ce combat passe par un engagement politique et collectif des populations concernées vivant les réalités sociales des quartiers populaires.
Durant la matinée, les interventions pour le lancement officiel de l’AQ ont décliné les enjeux de cette rencontre en insistant sur la nécessité d’instaurer un rapport de force pour se faire entendre, car, comme le précise un militant associatif, « ils veulent pas de nous en politique ». La notion d’engagement est fréquemment convoquée dans les différentes prises de parole des militant·es. De même qu’elle est mise en exergue sur le journal de l’AQ distribué à l’entrée de la salle. Un militant insiste particulièrement sur le fait que « l’engagement n’est pas un métier », pour se distancier des professionnels de la politique, issus parfois des minorités ethnoraciales, absorbés par les rouages du pouvoir et déconnectés de la base qui les a élus dans les quartiers populaires.
L’engagement, tel qu’il est décliné au sein de l’AQ, rappelle sa conception chez Howard Becker (2006), qui le décrit comme un processus par lequel un groupe ou un individu se
