Pourquoi se fier aux intuitions spécistes
Dans un article récent, intitulé « Pourquoi publier une revue antispéciste ? », Martin Gilbert en justifie l’existence par quatre raisons. Je ne discuterai ici que de la première, tout en mentionnant l’une des trois autres avec laquelle je suis en total accord : parce que, écrit l’auteur, « quand bien même les antispécistes auraient tout faux, […] c’est intéressant ». C’est cette raison qui fonde la présente réponse.
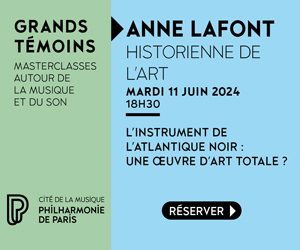
Le spécisme vu par les antispécistes
Le cœur du propos de Martin Gilbert est la dénonciation du « spécisme ». On peut dire de ce concept, à usage éminemment politique, qu’il est, pour utiliser l’expression de Walter Bryce Gallie, essentiellement contesté (ou controversé)[1]. La proposition de Gallie a donné lieu à une abondante littérature dont je ne parlerai pas ici. Il faut souligner que pour certaines notions (par exemple, la justice, la démocratie, etc.), ce qui importe est l’existence de nombreuses conceptions : ici, les désaccords sur le concept de spécisme déterminent les comportements des acteurs, à tel point qu’il est inutile d’espérer trouver un compromis définitionnel.
Si l’on retient la définition proposée par M. Gilbert, « discrimination en fonction de l’espèce », définition fidèle à celle de l’inventeur de la notion, le psychologie britannique Richard D. Ryder (dans un tract imprimé à Oxford), on décrira les comportements des humains en termes d’« oppression massive, violente et omniprésente, contre les animaux ». Ce qui fondera la lutte contre ces comportements est la description des animaux non humains comme des « individus » vis-à-vis desquels s’appliquerait « le principe fondamental d’égal traitement ». Si les antispécistes se limitaient à l’application de ce principe, la question serait de savoir si la caractérisation (« individus ») est plausible. Et à supposer qu’elle le soit, ce dont un philosophe politique doutera légitimement, les animaux non humains seraient-ils alors mieux protégés des indignes traitements des humains
