Politiques du dancefloor
« La fête, si elle est autre que célébration d’une puissance collective,
n’est que pure mascarade. »
C’est à partir de ce tag anonyme trouvé sur les murs de La Station – Gare des Mines que s’est déployée, en 2016, une recherche au long cours nourrie par l’expérience de la fête, lectures et entretiens, rencontres avec des formes et des pratiques artistiques dans le champ des arts visuels, de la danse et de la littérature.
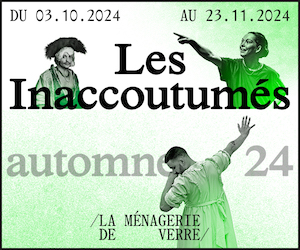
La fête est-elle apolitique, sans fonction sociale, générant ses propres codes au-dehors du monde[1] ? Ou, au contraire, agrège-t-elle des formes transgressives et subversives du social qui en font un espace éminemment politique ? Quelles seraient, alors, les coordonnées d’une politique du dancefloor ?
De 2016 à aujourd’hui, la question est toujours d’actualité, si ce n’est plus brûlante. De fait, dans une séquence marquée par les retours démagogiques et réactionnaires, l’amplification de la crise environnementale et un climat géopolitique marqué par l’essor des conflits armés, le durcissement législatif, dans nombre de pays, contre les droits des femmes et des communautés LGBTQI+ et le refoulement partout en Europe des exilé.es et migrant.es, la pratique de la fête peut paraître insouciante, inconsciente voire nihiliste confrontée à un monde qui se désagrège.
Pourtant, la proximité de la fête avec les luttes contemporaines et les espaces de transformation sociale, ainsi que la recherche par des communautés marginalisées de refuges, safe space, et espaces désirables dans et par la fête, remotive cette question de son caractère politique.
En parallèle, les signes d’une criminalisation progressive de la fête, actualisée depuis la crise sanitaire, sont à explorer comme la projection sur celle-ci, par le système dominant, du potentiel de déviance de ce territoire propice aux alliances intersectionnelles, à la réflexivité collective et au renforcement de la puissance d’agir des communautés.
Enfin, la fête contemporaine est cernée d’une part, pa
