Les ambiguïtés européennes de la France
Le 22 janvier 2019, dans un contexte européen préoccupant, les gouvernements allemand et français ont signé un nouveau traité portant sur la coopération et l’intégration franco-allemandes. Le terme intégration n’est pas un détail. Il ne figurait pas dans l’intitulé du précédent traité, le traité de l’Élysée signé en 1963 par de Gaulle et Adenauer, qui ne mentionnait que la coopération. Que signifie donc l’ajout de ce terme concernant la nature présente et future de la relation franco-allemande, si déterminante pour l’Europe ?
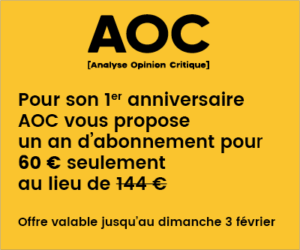
Pendant un demi-siècle, outre-Rhin, il a signifié sans équivoque un processus menant à terme la constitution d’un État européen de forme inévitablement fédérale. Mais qu’en est-il côté français ? Il faut reconnaître que durant toute la période, et sans doute encore aujourd’hui, l’ambiguïté est restée la règle. Il existe un problème structurel du positionnement de la France à l’égard du processus de construction européenne – et peut-être un problème plus fondamental de positionnement tout court de notre pays dans le monde. On peut formuler l’hypothèse que c’est là l’un des principaux écueils de la construction européenne.
Ainsi, selon une formule qui a cours outre-Rhin, la France – ce terme désigne ici son élite dirigeante – n’a cessé de vouloir contradictoirement « une Europe forte avec des institutions faibles ». Le nouveau traité franco-allemand souffre de la même ambiguïté. Tout en ambitionnant de lier toujours plus étroitement les politiques allemandes et françaises, en matière tant économique que sociale ou géopolitique, il ne propose que des institutions intergouvernementales somme toute assez faibles et dont l’efficacité sur le long terme restera tributaire des bonnes volontés réciproques. Autant dire qu’elles sont à la merci des aléas politiques et des influences étrangères.
L’Europe malade de la France ?
Affirmer que la France constitue le maillon faible du couple franco-allemand – et, à travers ce couple, de l’Europe – en fera peut ê
