L’héroïsation ambiguë des écrivains algériens en France
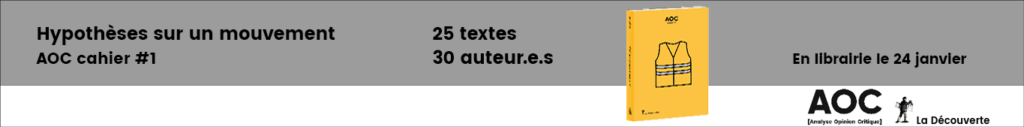
« Nouveaux Voltaires », « dissidents », « hérauts de la liberté »… Très visibles lors de la dernière rentrée littéraire, les écrivains algériens, comme aujourd’hui Boualem Sansal ou Kamel Daoud, sont héroïsés en France, et ce depuis la guerre civile des années 1990. On leur avait pourtant reproché leur « silence » lors des évènements terribles d’Octobre 1988. Que signifie cette héroïsation ? Réductrice et tendancieuse compte tenu de la complexité de leur engagement politique, elle est aussi paradoxalement le symptôme d’une difficulté à les considérer à égalité avec les écrivains français.
D’éternels perturbateurs ?
Si l’on peut dater grossièrement le reflux de l’engagement des écrivains français, et de leur position de parangon de l’intellectuel, à la mort d’Albert Camus en 1960, il n’en a pas été de même dans son pays de naissance. C’est assurément Kateb Yacine (1929-1989), du fait de son prestige international depuis la publication de Nedjma en 1956, et de ses positions très subversives en particulier à l’égard du pouvoir religieux, qui incarne le mieux l’écrivain dans sa dimension prophétique en Algérie, « au sein de la perturbation l’éternel perturbateur ».
Pourtant, bon gré mal gré, les écrivains ont été majoritairement partisans d’un statu quo politique pendant les années 1990. C’est le même Kateb Yacine qui écrit en octobre 1988 dans un article dans Le Monde, au moment où des émeutes populaires ébranlent le régime, « Le FLN a été trahi ». En tant que militants communistes, ou militants des droits de l’homme, ils ont certes vivement dénoncé les actes de torture. Mais ils n’ont que peu contribué, en tant qu’écrivains, à la politisation de ces émeutes, c’est-à-dire à leur requalification en appel à la démocratisation et à la libéralisation du régime. De même, en 1992, ils ont été majoritaires à soutenir l’armée dans l’arrêt du processus électoral qui allait donner la victoire au Front Islamique du Salut (FIS) et donc les moyens de changer la constitution, a
