Turban des Sikhs en Grande-Bretagne et hijab des musulmanes en France
Derrière ce qui apparaît comme une dichotomie facile opposant un « nous » républicain et hexagonal à un « eux » « anglo-saxon » et multiculturel se dessinent des trajectoires nationales, coloniales et post-coloniales complexes.
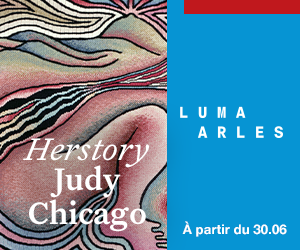
Au milieu des années 1960, le turban sikh a failli être constitué en problème public par un courant politique assimilationniste de l’autre côté de la Manche, mais il ne l’a finalement jamais vraiment été. A contrario, les controverses sur « le voile » en France ont commencé à occuper le terrain politique et médiatique à la fin des années 1980, engluant la république dans une spirale d’interdiction dont elle ne semble jamais sortir, même pendant le deuxième mandat Macron, soit près de trente-cinq années après la première « affaire du voile » au collège Gabriel Havez de Creil (1989).
Conducteurs de bus enturbannés
On est en 1967 à Wolverhampton, au nord-ouest de Birmingham. Dans cette ville industrielle, d’où l’élu conservateur Enoch Powell allait lancer une vaste campagne anti-immigration sur laquelle je reviendrai, un certain nombre d’immigrés Sikhs travaillent dans des usines ou conduisent des bus. Ces derniers sont très visibles de milliers de citoyens britanniques blancs, qui fréquentent quotidiennement les transports en commun.
Tarsem Sandhu est un de ces bus drivers. En juin 1967, après avoir été malade pendant trois semaines, ce jeune homme de 23 ans retourne au travail en portant un turban et en s’étant laissé pousser la barbe[1]. Pendant son arrêt, il a décidé d’opérer un virage personnel, l’ancrant davantage dans sa religion d’origine, et l’amenant à respecter les cinq piliers du Sikhisme, qu’on appelle souvent « les cinq K ». Le Kesh est l’un de ces préceptes cardinaux, qui suppose de ne pas se couper les cheveux ou les poils du corps, et de se nouer les cheveux[2]. Et c’est ce précepte du Kesh qui est au cœur du versant anglais de cet article.
Dans la ville des Midlands, la régie des transports publics exige des chauffeur
