« Nous ne sommes que de passage » : quand les émigrés africains aspirent au retour
La figure populaire des chibanis est devenue symbolique. Ces travailleurs immigrés, isolés et vieillissants, qui passent leur retraite en France, et dont seuls les cercueils connaîtront le dernier retour vers le village natal, sont le symbole d’une immigration qui perdure, même chez les oubliés de l’intégration, entretenant ainsi le « mythe » d’un retour sans cesse différé. La sociologie de l’immigration, longtemps focalisée sur les politiques d’intégration et leurs conséquences sociales, s’est jusqu’à très récemment désintéressée de ces migrations de retour, pourtant nombreuses.
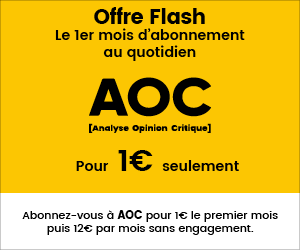
Si les immigrés pionniers ont longtemps envisagé l’immigration comme temporaire, tout comme les pouvoirs publics qui ont rapidement initié des programmes d’aides au retour[1], beaucoup de familles immigrées se sont installées en France à partir des années 1980. L’immigration s’inscrit progressivement dans un « provisoire qui dure », voire dans du « définitif vécu avec l’intense sentiment du provisoire » (Abdelmalek Sayad). À partir des années 1990, la sociologie fait peu de cas de ces aspirations au retour, considérées comme un « mythe » qui ne sert à l’échelle individuelle que des fonctions psychologiques, et à l’échelle collective qu’à affirmer la survivance identitaire des origines communes.
Pourtant, en 2015, l’INSEE a rendu publiques des données montrant que les retours d’immigrés augmentent. En 2006, près de 30 000 étudiants, travailleurs ou retraités immigrés ont quitté la France. En 2013, ils étaient plus de 95 000 à quitter le territoire. Cette brusque accélération pourrait simplement s’expliquer par le durcissement des politiques inhospitalières à l’encontre des immigrés et des étrangers. Mais elle semble s’inscrire dans des logiques sociales plus durables[2]. Quand on cherche à identifier les facteurs qui encouragent ces retours, ou les causes qui les freinent, trois types d’arguments sont spontanément évoqués : la personnalité des immigrés, leurs valeurs culturelles et leur par
