Jeux de propagations et politique des émotions
Nous avons donc vécu une « parenthèse enchantée », une « bulle de joie » avec ces Jeux olympiques à la maison. Voilà le diagnostic qui se propage, et chacun s’interroge sur ce qui a bien pu se passer et sur la durée de cet effet JO. On parle ici d’humeur du public plus que d’opinion, et les méthodes pour capter cet effet JO relèvent plus du doigt mouillé et du mimétisme que du sondage.
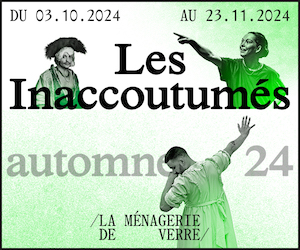
Quatre niveaux d’expérience s’entrelacent pour constituer ce récit d’ambiance : l’expérience du public présent dans les enceintes sportives, l’expérience urbaine collective à Paris, l’expérience médiatique de chacun (en France mais aussi dans le monde), dans ce suivi en direct des épreuves et des moments d’effervescence, repris et amplifié par les réseaux sociaux, et enfin l’expérience des conversations entre amis, collègues, voisins, après coup elles aussi reprises et amplifiées en ligne.
Dans chacune de ces expériences, se construit une dimension d’un état d’esprit, d’une humeur, voire d’un « climat », pour reprendre un terme de Sloterdijk issu de sa sphérologie[1]. Avec Stéphane Chevrier et Stéphane Juguet, nous avions étudié cette « climatisation urbaine »[2] lors de grands événements (manifestations, festivals, matchs de foot) à la fin des années 2000 et nous en avions tiré deux livres, dont l’un s’intitule La Ville-Événement[3]. L’imprécision des termes (ambiance, climat, événement) est importante car elle dit bien la difficulté à saisir cette dimension de l’expérience du social, du vivre ensemble, si l’on se place seulement au-dessus ou à l’extérieur. C’est en cela que les travaux de l’équipe du Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (CRESSON), et de Pascal Amphoux notamment[4], ou encore ceux du groupe de rythmologie autour de Luc Gwiazdzinski[5] sont importants car ils inventent des méthodes et des concepts pour saisir ces ambiances.
Comment penser ces moments de contagion ?
Malheureusement, ce phénomène social majeur, bien qu’éphémère, re
