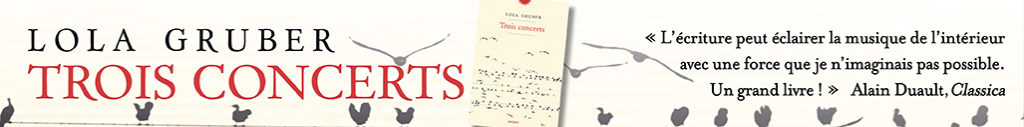Idées reçues sur l’école coloniale
Malgré les recherches menées depuis plusieurs décennies en sociologie et en histoire de l’éducation, nombre d’idées reçues sur l’école coloniale persistent dans l’ancienne métropole comme dans les anciennes colonies d’Afrique-Occidentale française.
Elle est présentée soit comme l’outil par excellence de la « mission civilisatrice », dont le seul horizon aurait été l’émancipation des colonisés, soit comme l’instrument surpuissant de la colonisation mentale et culturelle éradiquant les cultures africaines et produisant des générations scolaires « aliénées ».
Quoique leurs attendus ne soient pas les mêmes, voire s’opposent frontalement, ces représentations révèlent que le mythe d’une école coloniale exclusivement assimilationniste est encore dominant. Si ce mythe a la vie dure, c’est aussi qu’il entretient les clivages actuels des imaginaires et des mémoires autour de « la colonisation ».
Idée reçue n° 1 : L’école coloniale comme « émancipation »
L’école coloniale est parfois mise au compte des « bienfaits » de la colonisation, au même titre que les routes et les hôpitaux, atténuant par là-même les « abus », violences et crimes commis à l’encontre des populations colonisées. Dans les colonies françaises de l’Afrique Occidentale Française, la proportion d’enfants en âge d’aller à l’école effectivement scolarisés est pourtant restée bien maigre : le taux de scolarisation en Afrique-Occidentale française est d’à peine 10% à la veille des indépendances. Il ne fut à aucun moment sérieusement question de viser la scolarisation universelle comme en métropole. Par ailleurs, le nombre d’élèves se réduisait drastiquement, à partir du cours moyen et encore davantage après l’école primaire.
L’École normale William Ponty, où étaient formés les instituteurs africains, constituait alors le sommet de la hiérarchie scolaire en AOF, que seule une infime minorité a pu atteindre. L’augmentation exponentielle des effectifs après 1960 montre bien que les indépendances des États a