Ethnographier la mondialisation
Réputé casanier, le peintre Johannes Vermeer est connu pour une œuvre dont les pièces les plus remarquables sont des scènes d’intérieur relatant la vie quotidienne de la bourgeoisie hollandaise du XVIIe siècle. On y voit des femmes lire et écrire des lettres, jouer du luth, de la guitare, de la flûte, du virginal, rire de propos galants. Autant de témoignages des activités ordinaires rythmant les existences bourgeoises durant le siècle d’or néerlandais.
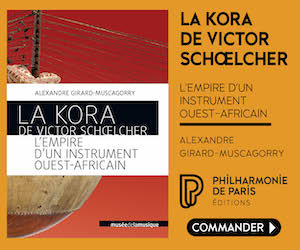
En y regardant d’un peu plus près, l’espace apparemment clos des chambres et des salons qui renferme ces scènes s’étoile et s’ouvre au monde. Un détail – une porcelaine, un tapis, un chapeau – trahit l’envers du décor et révèle les vastes réseaux marchands d’une mondialisation naissante, faite d’expéditions au long cours, de massacres, d’incompréhensions, de négociations et de commerces en tous genres.
C’est cette rencontre frappante entre l’espace domestique peint par Vermeer et la mondialisation telle qu’elle se déroule au XVIIe que Timothy Brook raconte dans son ouvrage Le Chapeau de Vermeer. À partir du chapeau de feutre qui coiffe la tête de l’officier hollandais dans le tableau L’Officier et la jeune fille riant, Brook explicite la mécanique des mouvements globaux en retraçant l’entreprise coloniale française au Canada, la guerre menée par Samuel de Champlain contre les Mohawks et la maîtrise du commerce des fourrures de castor nécessaires à l’élaboration du feutre dont étaient faits ces chapeaux hautement convoités en Europe. Un détail de la toile – le chapeau de feutre – devient le point fixe d’un réseau mobile, fait d’alliances indiennes, de négociations transatlantiques, de coureurs des bois, de chasses aux castors, de relevés cartographiques incertains, de transactions incomplètes, d’explorations inachevées, d’épidémies et de famines.
Il y a, dans la manière qu’a Brook de représenter les réticulations heurtées au cœur de la mondialisation du XVIIe siècle, une perspective qui garde toute sa pertin
