Écocide, urbicide, technologie : nouvelles leçons guerrières au Proche-Orient
D’aussi loin que je me souvienne, deux types de traces matérielles subsistent aux guerres : les traces visibles, comme par exemple les infrastructures reconstruites modifiant certains axes urbains, les façades trouées des immeubles qui n’ont pas été rebouchées ou l’installation de postes de contrôle, et les traces invisibles, celles qui rongent de l’intérieur, celles dont on ne sait comment parler et dont on a du mal à identifier les tenants, celles qui sont psychologiques ou traumatiques.
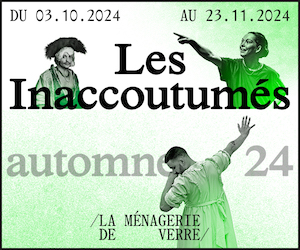
Mais, depuis un an, la guerre amène un nouveau lot de considérations, jusqu’alors peu prises en compte dans les débats portant sur la ville lorsqu’il s’agit de conflits : les dimensions écologique, constructive et technologique.
Dans un contexte où les corps humains des uns ne semblent pas avoir la même valeur que ceux des autres, où les statistiques révélant le nombre de décès et de blessés ne semblent pas affecter le moindrement les institutions responsables, parler d’écologie, de construction et de technologie sont les dernières cartes à jouer pour se faire visible puisqu’elles font partie des enjeux sociétaux contemporains occidentaux et capitalistes et qu’elles peuvent encore intéresser ou peut-être capter l’attention des pouvoirs. Pour exister, pour continuer d’être et ne pas être oublié, faire ressortir la carte écologique (une véritable injonction), la construction (une mode passagère chez les architectes) et la technologie (de plus en plus indispensable) pour se faire entendre. Et, à défaut de perdre le lectorat qui ne semble pas concerné par la complexité d’une situation géopolitique trop lointaine, ne plus parler de la guerre comme d’une injustice trop souvent abstraite, mais aborder le sujet depuis l’actualité et les intérêts de l’Ouest.
De l’écocide, ou ignorer la biorégion
Dans un monde de plus en plus conscient des changements climatiques et de leur impact, dans un contexte où de plus en plus d’écocides[1] sont mis en accusation, dont plusieurs liés à des
