Dénaturaliser la valeur économique en démocratie
«Les valeurs sont le sens que l’on choisit de donner à sa vie. » Cette citation de Jean-Paul Sartre éclaire un des points aveugles de la science économique orthodoxe : il n’existe pas une valeur (économique), mais des valeurs (sociales). C’est pourquoi, à la suite de quelques chercheurs tels que Jean-Marie Harribey, Jean-Joseph Goux ou David Graeber[1], nous pensons qu’il est indispensable de rouvrir le débat théorique sur ce qui fonde la valeur économique et ce qui la relie aux valeurs sociales.
Avant de présenter le cadre théorique de notre propre approche délibérative de la valeur, qui vise à encastrer la théorie de la valeur économique dans une théorie plus large de la formation des valeurs en société démocratique, nous allons revenir un peu sur l’histoire qui a conduit à l’adoption de la théorie actuelle de la valeur, à savoir la théorie marginaliste de la valeur, que nous présenterons également.
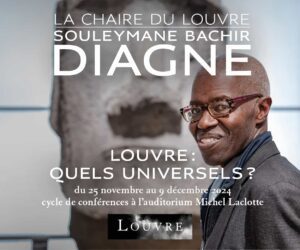
Un peu d’histoire
Dans son livre La Valeur (1943), l’économiste François Perroux, qui œuvre, sous le régime de Vichy, pour une institutionnalisation de l’économie comme science humaine dominante, rappelle l’enjeu épistémologique pour la science économique de la valeur : dépasser le sens commun pour construire une loi explicative comme le fait l’astronomie en mettant au jour le fait que c’est la terre qui tourne autour du soleil, et non l’inverse : « Le prix, réalité très visible et à laquelle nul n’échappe, n’apparaît pas comme la réalité économique la plus profonde, ni comme la plus générale. Choisir de poser le problème en termes de valeur, c’est choisir de rechercher le sens et les lois de toute économie quelle qu’elle soit […]. La théorie de la valeur représente l’effort de penser ensemble la réalité économique en poussant l’explication aussi loin et profond que possible[2]. »
L’enjeu est donc celui de la scientificité : faire de l’économie une « vraie » science donnant une explication universelle et atemporelle aux choses. Le modèle est donc celui des sc
