Malaise dans la culture mémorielle allemande
Quelque chose ne tourne pas rond dans la culture mémorielle allemande. Du moins le malaise est-il assez profond pour qu’une chercheuse aussi emblématique de l’ouverture internationale de la vie intellectuelle allemande que la philosophe américaine Susan Neiman, directrice du Einstein Forum de Potsdam, estime, lapidaire : « Aujourd’hui, en Allemagne, Hannah Arendt n’aurait plus le droit de parler »
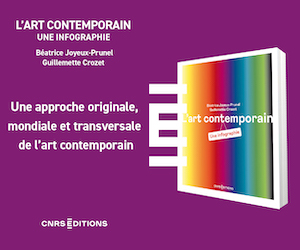
Pure vue de l’esprit, bien sûr, Arendt s’étant éteinte à New York en 1975 ; mais imaginer l’icône de la pensée du XXe siècle, chassée par les nazis, à nouveau condamnée au silence outre-Rhin, a de quoi donner le tournis.
Spécialiste des Lumières, figure de la gauche libérale américaine, autrice d’ouvrages à la jonction entre philosophie morale et analyses politiques contemporaines – dont le récent La gauche n’est pas woke (2024) –, Neiman avait, comme bien d’autres essayistes d’origine juive avant elle, tendu aux Allemands le miroir positif dont la sphère politique et la société civile allemandes se montrent friands. Dans son Learning from Germans (Apprendre des Allemands, 2019, non traduit en français), elle examinait les efforts menés outre-Rhin pour expier le nazisme, attribuant la mention Très Bien aux dispositifs politiques, pédagogiques et d’ordre symbolique ayant contribué au développement d’une culture démocratique ouverte appuyée en creux sur la « mémoire négative » (Reinhart Koselleck) de la Shoah[1].
Neiman allait jusqu’à présenter ce qu’il est convenu d’appeler la « Erinnerungskultur », la culture mémorielle allemande, comme un modèle pour les Américains, au regard du passé d’esclavage de leur propre pays[2]. Elle n’était d’ailleurs pas la première, ni la plus célèbre à louer ainsi ce travail de mémoire. Auteur d’Être sans destin et de Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, prix Nobel de littérature, survivant d’Auschwitz devenu Berlinois de cœur après 1989, l’écrivain hongrois Imre Kertész répétait à l’envi sa confiance dans la « force et la maturi
