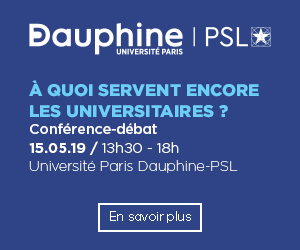Les mémoires partagées de l’Europe
Être ou ne pas être européen… Alors que le Brexit – convulsions encore en cours – semble démontrer jour après jour « l’impossibilité d’une île », la perte de sens de l’Union est partout sensible. Même sans trémolos shakespeariens, la question, qui porte d’ailleurs moins sur l’Europe que sur la question des appartenances, ne devrait pas surprendre : « “l’Europe” est et a toujours été une invention inachevée et contestée » selon l’historien indien Sanjay Subrahmanyam.
À l’approche d’élections européennes que d’aucuns disent fatidiques, le contexte invite à s’interroger sur ce qui nous rassemble et ce qui nous divise. Deux paradoxes inversés se font face : malgré les malentendus et le retour en force des égoïsmes nationaux, le sentiment d’avoir quelque chose en commun demeure bien réel ; inversement, le national fête depuis quelques temps déjà son grand retour, alors même que la densité des imbrications n’a jamais été aussi apparente. Interroger la possibilité d’un « nous », certes fragile et souvent contradictoire, mais d’un « nous, quand même », telle est en somme la question.
L’histoire n’est pas la plus mal placée pour apporter des fragments de réponse. Notre conviction, mise en œuvre dans l’ouvrage collectif Europa. Notre histoire publié l’an passé, est que l’analyse de l’enchevêtrement des mémoires collectives est à même d’éclairer les enjeux complexes qui taraudent les opinions publiques européennes.
L’histoire est en effet mobilisée par tous les courants qui s’emmêlent. Sans doute, le délitement du projet européen va-t-il de pair, dans son substrat le plus profond, avec le « présentisme » diagnostiqué par François Hartog, à savoir l’essoufflement d’une manière de nous concevoir dans l’histoire et de (ne plus) nous projeter dans le futur. Si les raisons plus directement politiques du désenchantement sont légion, cette mutation fondamentale affecte assurément l’élan à la fois téléologique, providentialiste et éternaliste qui a plus ou moins inconsciemm