Notre-Dame ou quand la forêt crépite
L’émotion qui a saisi le pays le 15 avril au soir mérite d’être scrutée avec discernement. Alors que les flammes s’emparaient de la flèche et dévoraient inexorablement la toiture, les cœurs étaient serrés face à la vulnérabilité d’un édifice qu’on croyait indestructible.
Mais une fois passée la crainte d’un effondrement du bâtiment, il faut interroger l’étrange sentiment qui affleure.
Puisque la structure de pierre et de verre est pour l’essentiel sauvée, et qu’aucun pompier n’a péri face au feu, il ne s’agit pas véritablement d’un deuil. L’incendie a produit autre chose, de bien plus intéressant. La communauté nationale se découvre sourdement liée à un passé lointain, sans bien savoir comment nommer ce lien. Pour essayer de le traduire très simplement, on pourrait formuler ainsi ce constat : nous aurions quelque chose à voir avec le Moyen Âge, et cette actualité serait, si j’ose dire, brûlante.
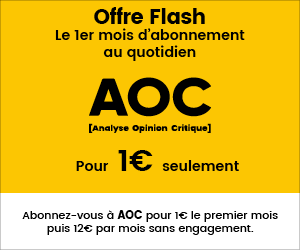
Notre-Dame n’est pas sans raison le lieu où se concentre le plus intensément un rapport à cette période de l’histoire de France, mal connue du grand public, mais que l’on perçoit pourtant confusément comme son moment inaugural. Avant 1200, les Capétiens ne contrôlent en effet pas grand-chose. Aussi passionnantes soient-elles, toutes les histoires qui se sont déroulées sur ce sol avant le XIIe siècle n’ont pas eu d’effets aussi déterminants et durables sur les formes de la vie collective que les machineries qui se mettent en branle à cette époque : Église issue de la réforme grégorienne encadrant étroitement la vie des fidèles ; institutions royales, féodales et urbaines d’où proviennent par dérivations successives les institutions politiques, judiciaires, administratives et fiscales modernes ; écoles et université qui n’ont, quant à elles, guère évolué dans leur fonctionnement.
La construction d’une cathédrale au cœur de ce qui devient soudainement l’une des plus grandes villes d’Occident, la capitale d’un royaume puissant et le principal centre intellectuel de la chrétient
