Anticiper Los Angeles en feu
Le 8 novembre 2018, la ville californienne de Paradis – on ne saurait l’inventer – part en fumée. C’est l’année aux vingt mille bâtiments détruits par les flammes. On plaide pour l’accident. Mais d’une ville on ne dit pas qu’elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Des mots comme mégafeux, pyrocumulus ou tempête de feu ont depuis fait advenir cette réalité chronique qui ne cesse de nous rappeler la vulnérabilité de ce que l’on pensait inaliénable aux forces dites de la nature. En 2012 et 2013, alors que je séjourne à Venice, à Berkeley, à Palm Springs, nul événement incendiaire ne vient perturber l’idylle itinérante et studieuse, mais de temps à autre se découpent dans le paysage des veines sombres, des reprises de végétation tendre – les traces immenses, à travers les canyons et les collines, du passage des flammes.
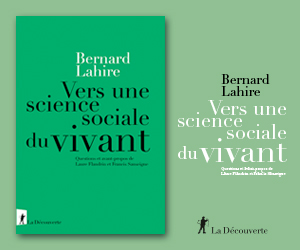
En 2020, c’est tout l’Ouest américain qui se trouve dévoré. Des centaines de feux atteignent les bourgades des contreforts. Ils remontent les pentes et s’engouffrent dans les vallées, accélérés par les courants catabatiques, à des vitesses jamais vues. Leur avancée et leur cap déjouent les stratégies déployées pour les contenir. Les particules risquent de contaminer les réservoirs et l’eau potable de toute la région. Dans des ciels oranges, les cendres floconnent en continu à des dizaines de kilomètres de leurs points d’ascension. Les titres de presse sont éloquents : « San Francisco or ‘Mars’ ? », « San Francisco set to Blade Runner ». Les incendies menacent d’encercler les géants de la Tech, ceux-là même qui, résolument transhumanistes, échafaudent des plans B : la planète Mars, mais surtout des pavillons-bunkers à Hawaï, en Patagonie, en Nouvelle-Zélande. Ce n’est pas de la cendre qui tombe, ce sont des poussières de maisons et d’abeilles.
Parmi les affects environnementaux, la notion de solastalgie avancée par le philosophe australien Glenn Albrecht pour décrire la détresse éprouvée d’être quitté par son lieu – et plus seulement d
