Liberté surveillée – sur Shimoni d’Angela Wanjiku Wamai
Shimoni d’Angela Wanjiku Wamai donne l’impression d’un film didactique. La faute peut être attribuée à ses dialogues, remplis de phrases allégoriques renvoyant à son intrigue. C’est le cas dès l’ouverture du film où un maton prévient Geoffrey à sa sortie de prison : « Laisse de la place pour les autres. » Filmée depuis l’habitacle d’une voiture où l’attend un prêtre, cette libération donne lieu à un nouvel enfermement : Geoffrey revient dans son village d’enfance, Shimoni, où il va devenir l’homme à tout faire d’une église catholique, de son presbytère et de la ferme avoisinante.
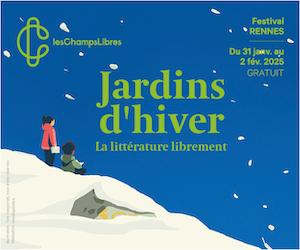
Là, il est encadré par le Père Jacob, curé de la paroisse, et Marthia, travailleuse à la ferme qui veille à ce que l’ancien professeur d’anglais soit bien à l’heure pour traire les vaches. Cette levée d’écrou a tout d’une liberté surveillée et c’est assez ironiquement que résonne la réplique que lui adresse le Père Jacob une fois arrivé à Shimoni : « Tu survivras à la liberté. »
Pour autant, ce didactisme allégorique se joint à un certain laconisme, du moins un mystère reléguant le passé et les souvenirs au hors-champ. C’est progressivement que l’on découvre les raisons de l’incarcération de Geoffrey, qui jusqu’alors paraissait bien sous tout rapport, et celles de sa panique à l’idée de croiser Weru, un paroissien qui travaille au cimetière, identifiable par sa mèche de cheveux dépigmentée. Paradoxalement, c’est par des effets physiologiques et symboliques très clairs que ce mystère se construit. Après avoir croisé pour la première fois Weru, Geoffrey fait sous lui et abat de ses poings une chèvre dans la bergerie : la violence impulsive découle d’un silence qui n’a pas d’autres moyens d’expression que des réflexes régressifs et infantiles. La mise en scène traduit le traumatisme sans nuance à l’instar du tonnerre qui résonne lorsqu’il croise Weru pour la deuxième fois.
En définitive, la libération de Geoffrey rejoue les événements qui ont précédé son incarcération. Lorsqu’i
