Philippe Descola : « Notre-Dame-des-Landes est une expérience politique aussi originale que la Commune de Paris »
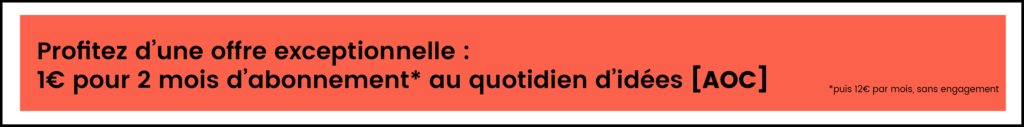
Pour fêter leur dixième anniversaire, les précieuses éditions Wild Project – maison fondée et animée par Baptiste Lanaspeze – font paraître un livre en forme de cartographie collective des pensées de l’écologie, un livre qui réunit des entretiens réalisés par Marin Schaffner avec des chercheur.e.s (Baptiste Morizot, Emilie Hache, Bruno Latour, Anne Simon, Isabelle Stengers, Catherine et Raphaël Larrère…), des journalistes (Jade Lindgaard, Hervé Kempf…) ou encore l’éditrice Isabelle Cambourakis. En avant-première, Wild Project a confié le texte de l’un de ces entretiens à AOC, celui que l’anthropologue Philippe Descola a accordé à Marin Schaffner. Le professeur au Collège de France y évoque son rapport très ancien aux questions écologiques, et la manière dont elles s’articulent à la discipline anthropologique, et plus largement aux sciences sociales. AOC
Comment en êtes-vous venu à l’écologie ?
Au début des années 1970, lorsque j’avais une vingtaine d’années, la question écologique m’intéressait déjà – j’étais alors militant politique à l’extrême gauche. Mais cette question écologique était abordée de façon très marginale (comme le féminisme d’ailleurs). Quand j’ai décidé de m’intéresser à ces questions-là en tant que savant, c’est-à-dire d’étudier les rapports entre des sociétés et leurs environnements, et d’étudier plus largement ce que c’est que d’habiter le monde d’un point de vue comparatif, je me suis lancé là-dedans sans avoir le sentiment que je participais à un mouvement plus général, dans la mesure où – bien que contemporain des premiers mouvements d’écologie politique – j’avais le sentiment que, à quelques personnalités près, c’était une écologie assez gestionnaire et qui s’intéressait à des questions plutôt techniques, et pas du tout à des questions plus largement politiques. Or, ce qui me frappe depuis une bonne dizaine d’années, justement, c’est que cette prise de conscience que l’habitabilité de la Terre est quelque chose de profondément politique
