La philosophie et ses dehors : interdisciplinarité et décloisonnement des pratiques
La philosophie contemporaine ressent l’urgence de s’ouvrir à la multitude des dehors : les autres disciplines, les pratiques du monde social, au premier rang desquelles les pratiques artistiques et les pratiques politiques. La chose n’est sans doute pas nouvelle. Il suffit de penser à l’importance des mathématiques, de la poésie et des méandres politiques hellénistiques chez Platon, pour constater que, de tout temps, la solitude de la philosophie a été solidaire de son attention à ce qui n’est pas elle. Cependant, tant qu’elle s’est pensée comme reine des sciences et qu’elle se concevait comme la science des fondements et des premiers principes, la philosophie pouvait concevoir cette altérité comme quelque chose d’accidentel et d’inessentiel : elle avait pour elle un champ du savoir qui lui était réservé et qu’elle était seule à pouvoir défricher. Chez Descartes ou chez Kant, par exemple, la philosophie n’était pas séparable des découvertes de la physique mathématique de leur temps, et pourtant l’entreprise de fonder les sciences lui donnait son autonomie propre.
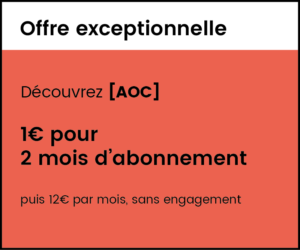
Or il semble que la philosophie contemporaine ne croit plus en cette entreprise de fondement, qui lui permettait de s’attribuait une certaine prépondérance hiérarchique par rapport aux autres disciplines et pratiques. Elle sait que la science, l’art, la politique peuvent faire sans elle, et qu’elle doit s’y rapporter sur un nouveau mode, celui de la collaboration. Les philosophes, en effet, n’œuvrent plus seuls : pour affronter les questions de morale et de bioéthique, ils travaillent avec des médecins et des personnels soignants ; pour comprendre la dynamique du monde social, ils collaborent avec des économistes, des sociologues, des anthropologues ; pour saisir le fonctionnement de l’esprit humain, ils s’imprègnent de neuroscience, de linguistique, de psychanalyse ; pour penser la résistance au monde tel qu’il est et l’activité de critique sociale, ils se tournent vers la littérature, la peinture, le cin
