Élections européennes : le risque référendaire
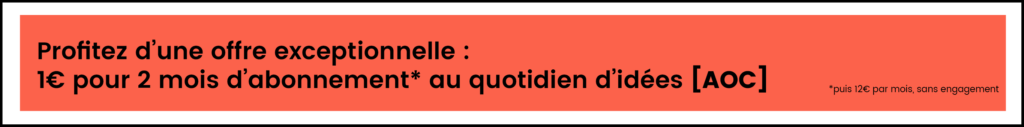
En France, un risque majeur plane sur les élections européennes du 26 mai 2019 : celui de n’être que marginalement européennes et très nationalisées. Pour cinq raisons.
La première raison tient à un changement des règles du jeu. La régionalisation du scrutin, mise en place en 2004, 2009 et 2014 est abandonnée. Les huit grandes circonscriptions euro-régionales disparaissent au profit de la circonscription nationale unique (loi du 25 juin 2018) qu’on avait connue aux européennes de 1979 à 1999. Or, ce changement contribue à puissamment nationaliser cette élection. Cela se manifeste concrètement au niveau du nombre de listes et au niveau des thèmes de campagne.
En 1999, lors du dernier scrutin européen qui s’était joué dans une circonscription unique, on comptait en tout et pour tout 20 listes. En 2004, la régionalisation des circonscriptions avait largement ouvert l’offre électorale avec une multiplication des listes (168), qui avait atteint un record en 2014 (193 listes, dont 31 rien que dans la circonscription Ile de France). En 2019, l’offre électorale s’est refermée mécaniquement puisque le nombre de listes est limité par l’obligation de présenter des listes nationales portant chacune 79 noms (soit le nombre équivalent de sièges à pourvoir pour la France).
Certes 34 listes en 2019 c’est plus que 20 en 1999 : on peut y voir une manifestation de l’éclatement et de la fragmentation du système partisan. Mais aussi le cumul d’un triple effet d’aubaine : le scrutin proportionnel, à la différence du scrutin majoritaire, ouvre « l’accordéon électoral » (selon la formule de Jean-Luc Parodi) puisque chaque liste ayant obtenu au moins 5% des suffrages bénéficie d’un nombre de sièges proportionnel à son nombre de voix ; chaque liste en présence bénéficie désormais d’un accès aux chaînes de radio et télévision publiques ne serait-ce que pour une durée d’émission forfaitaire de 3 minutes (loi du 25 juin 2018 modifiant les règles de la campagne audiovisuelle officielle, qui doi
