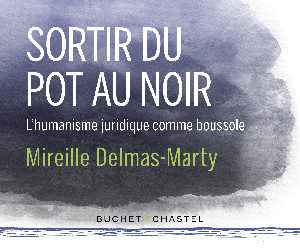Soudan : poker menteur à Khartoum ?
J’avoue ma perplexité devant l’évolution de la « révolution » soudanaise. Certes, j’ai connu l’intifada populaire d’avril 1985, et les conflits qui ont dévasté le pays, au Sud, dans les monts Nouba, au Darfour [1]. Du Caire à Ndjamena, de Nairobi à Asmara, j’ai fréquenté tout au long de ces décennies les opposants de tout le spectre politique, bien souvent connus durant les années passées à l’Université de Khartoum. L’expérience ne préjuge certes pas de la compétence, mais elle permet d’entrevoir ce qui se joue entre les acteurs dans les moments où l’histoire bascule.
La première constatation est l’écart entre la ronde joyeuse des commères martelant en chantant leurs casseroles « Nimeiri ma fi, ha nechrab whisky safi ! »[2] en avril 1985, et le bras de fer actuel des jeunes instruits qui tiennent bon, depuis décembre dernier, face à la soldatesque du régime.
À l’époque, le monde était encore partagé en deux camps : Nimeiri, corrompu et inefficace, avait été remercié par George Bush, et sur le chemin de son retour de Washington, les mains vides, il avait été débarqué sans coup férir. L’armée avait pris les rênes avec le général Siwar el Dahab, un gouvernement de technocrates avait été chargé de redresser la situation économique, avant que des élections générales un an plus tard n’amènent au pouvoir un Sadiq el Mahdi, qui pour la seconde fois – après une première expérience de premier ministre en 1965-66 – conduirait le pays à la catastrophe : ses atermoiements à négocier avec la rébellion sudiste conduiraient au coup d’État militaire du 30 juin 1989, quatre ans seulement après la chute de Nimeiri.
Le talon d’Achille du Soudan était en effet la question du Sud : les Sudistes avaient été livrés par les Britanniques sur le départ aux dignitaires enturbannés des confréries du Nord. Ils revendiquèrent dans un premier temps l’indépendance, et obtinrent en 1972 une large autonomie, après déjà de lourds sacrifices ; puis celle-ci leur fut reprise en 1983, dès q