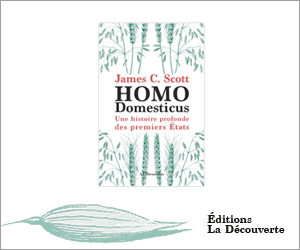Crise de l’Europe : une crise des vocations ?
Une fois encore, les élections européennes n’ont pas particulièrement mobilisé les citoyens européens, en France notamment. Certes en augmentation par rapport à 2014, la participation au scrutin du 26 mai s’est élevée à 51%. Cette faible mobilisation est souvent rapportée à une forme de défiance à l’égard de l’Union européenne. Elle est souvent considérée comme lointaine et peu concrète.
La distance des citoyens est redoublée par une « crise » interne à l’Union européenne, ce qui le Brexit ne fait que renforcer. L’Union européenne est en « crise ». C’est un constat unanime et récurrent. De nombreuses tentatives d’explication l’accompagnent. Elles évoquent tour à tour les « pannes de l’intégration européenne », « l’impasse » dans laquelle les chefs de gouvernement successifs se seraient enfermés, un « effet de fatigue » du processus d’élargissement européen, voire la « grande récession », « l’échec » ou le « déclin » de l’UE. Parmi les conséquences de cet état de crise devenu permanent, la « déprime des eurocrates » est évoquée [1]. Le projet européen serait devenu « démodé ». « L’Euro Bubble » aurait perdu de son intérêt et de son pouvoir d’attraction. De moins en moins de personnes, voire quasiment plus personne, y compris au sein des institutions européennes, « croiraient » encore au projet européen.
Pourtant, l’attractivité de l’Europe politique ne se dément pas. De nombreux jeunes souhaitent s’orienter vers les métiers qui se sont développés avec la construction européenne , et faire partie du monde des eurocrates : plusieurs milliers de personnes [2] font carrière dans les institutions européennes (fonctionnaire européen, assistant parlementaire au Parlement européen, etc.), ou en lien avec celles-ci (chargé de projet européen au sein d’une collectivité territoriale, représentant d’intérêt ou « lobbyiste » pour une entreprise ou une association, etc.), circulant d’un poste à un autre. Au local-national ou à Bruxelles, ces « insiders » ou « permanents