Européennes, le retour aux urnes ?
Pour la première fois depuis vingt-cinq ans, la participation électorale aux élections européennes a repassé la barre symbolique des 50% d’inscrits, mobilisant un citoyen français sur deux en capacité de voter, quand l’abstention s’était, depuis le tournant des années 2000, stabilisée à un niveau élevé : 59 % en 2009 et encore 57% en 2014. Cette remobilisation relative d’une partie de l’électorat potentiel suscite d’autant plus d’intérêt qu’elle constitue une surprise au regard des records attendus d’abstention : selon les sondages qu’ils prenaient pour référence, les médias avaient préparé les esprits à enregistrer a minima 57% d’abstention – le taux atteint en 2014- quand d’autres annonçaient jusqu’à 60%.
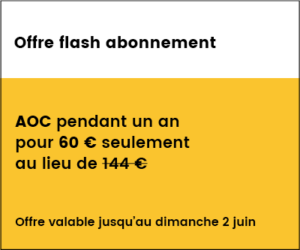
Il convient de ne pas minimiser la réalité de la dynamique observée le 26 mai 2019, à bien des égards à contre-tendance de ce qu’on observe depuis plus d’une décennie, au cours de laquelle l’abstention n’a cessé d’augmenter pour tous les types de scrutin. En juin 2017, le record historique de 57% d’abstention enregistré au 2ème tour des législatives marquait même symboliquement le fait que ce scrutin national fondateur de notre démocratie ne se révélait désormais pas plus capable d’intéresser les citoyens que les Européennes traditionnellement les moins attractives de toutes nos élections.
Comment comprendre, dans ce contexte, ce qui s’est passé dimanche, perceptible aussi bien depuis le centre de Paris que depuis les quartiers populaires de Saint-Denis, la participation électorale ayant progressé partout de 8 points environ par rapport aux dernières Européennes ?
Un Président « candidat » qui a mobilisé pour et contre lui
D’abord, en évoquant la question du calendrier électoral. Dans un pays où les années sans scrutin sont rares, les Européennes de 2019 surviennent après une période de deux années entières sans élection, ce qui n’était le cas ni pour celles de 2014, ni pour celles de 2009. Elles constituent donc les premières élections intermédiaires, après une
