Vous avez dit « backlash écologique » ?
En 1972, la revue Nature se demandait si le « backlash environnemental » (environmental backlash) avait fini par arriver aux États-Unis. Les mobilisations qui avaient marqué la « semaine de la Terre » (Earth week) l’année précédente étaient cette fois-ci passées presque inaperçues et la Chambre des Représentants venait de voter un texte régressif sur le plan environnemental. Un demi-siècle plus tard, la situation ne semble guère différente : le succès des marches pour le climat de 2018 et 2019 n’a pas été reproduit, les partis écologistes ont connu un reflux important aux élections de 2024 et la Commission Européenne a largement revu ses ambitions climatiques à la baisse.
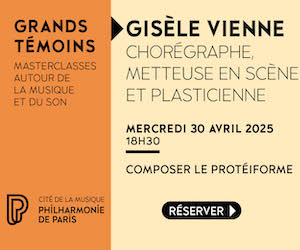
Mais, comme le notait Matthew Paterson en 1999 dans sa recension de quatre ouvrages (déjà) consacrés au backlash, s’étonner que l’écologie puisse susciter des résistances exige une certaine naïveté, comme si les intérêts économiques qui président à l’inaction devaient s’effacer d’eux-mêmes derrière la justesse de la cause. Quelle est donc la pertinence de ce terme pour les sciences sociales en général, et pour l’écologie en particulier ?
Une approche réactive
La popularité du backlash tient en partie à son utilisation par Pippa Norris et Ronald Inglehart dans leur ouvrage de 2019 consacré au Brexit et à l’élection de Donald Trump. L’idée au cœur du livre est relativement simple : la libéralisation des mœurs d’une société place progressivement la partie de la population qui continue à adhérer à une vision conservatrice du monde en situation de minorité, stimulant chez ces derniers une réaction défensive. Cette divergence prend la forme d’un conflit générationnel, les plus jeunes étant aux avant-postes de la libéralisation des mœurs, tandis que leurs ainés cèdent à une tentation autoritaire.
Cette approche réactive du backlash suggère une forme de passivité de la part de la société dont les préférences électorales sont supposées réagir mécaniquement à un changement des mœurs. Elle néglige a
